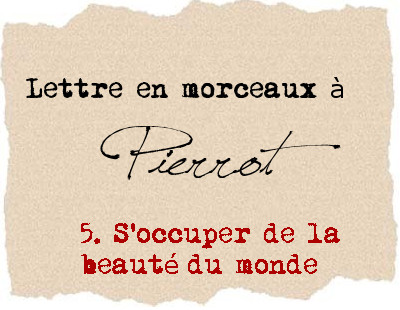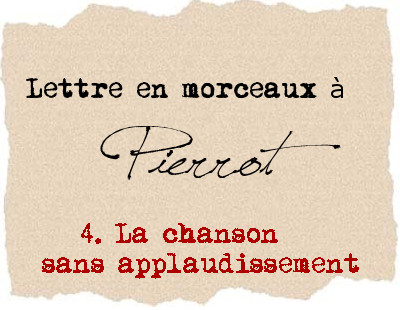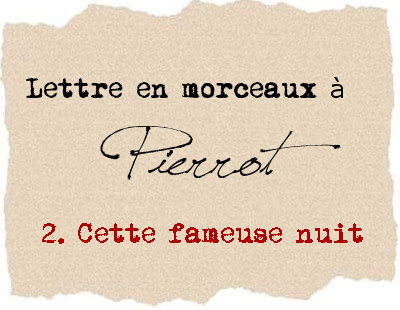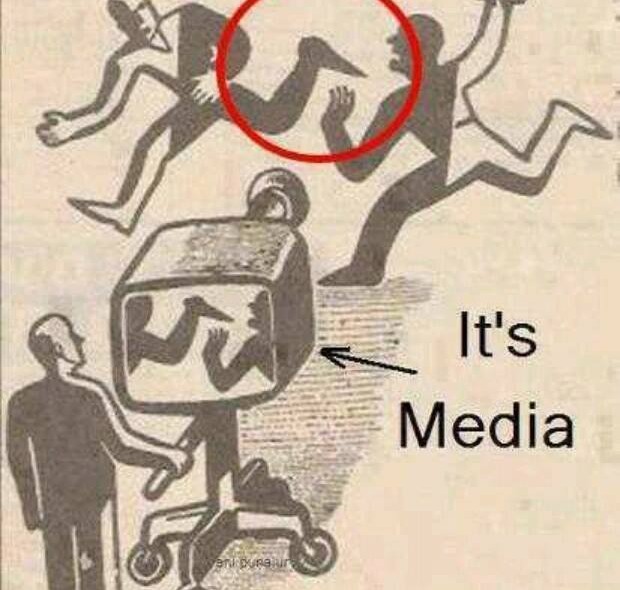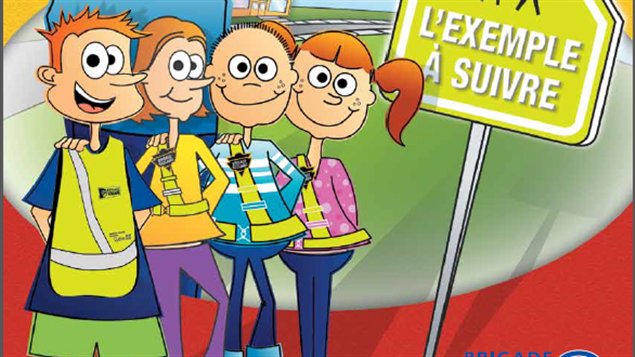Pris entre l’image du bon sauvage et celle de parasite de la société, les autochtones de l’Amérique du Nord doivent se réinventer. Guérir leurs blessures, trouver des voies vers l’autonomie, se trouver une identité contemporaine. Ce travail se fait au jour le jour avec des allochtones qui ont fait le choix de vivre en permanence sur les réserves. Portraits croisés de ces ouvriers de la réconciliation, à Wemotaci, réserve Atikamewk du Québec.
Il y a des pays qui n’ont besoin ni de barbelés ni de murs pour maintenir une population à l’écart. Ce pays est grand comme quatorze fois la France et ses territoires d’outre-mer, et deux fois moins peuplé. Il y aurait assez de place pour tout le monde, semble-t-il. Pourtant, au Canada, une population vit à part, sur des territoires morcelés, les réserves. Ce sont ses premiers habitants, les autochtones. Parmi eux, les Amérindiens regroupant cinquante Nations, les Inuits et les Métis.
Moins de la moitié des 1.4 millions de personnes se déclarant autochtones vit sur des réserves, la majorité ayant fait le choix de vivre en ville[i]. Aujourd’hui, les autochtones doivent s’inventer une nouvelle manière d’exister dans la société moderne sans renier leur culture.
« Les autochtones doivent rester dans un statut de tutelle et être traités comme des pupilles ou enfants de l’État ». Cette phrase est issue du rapport du Ministère de l’Intérieur de 1876 après la création de la Loi sur les Indiens[ii], encore en vigueur aujourd’hui. Malgré ses nombreux amendements[iii], cette loi continue à faire des autochtones des citoyens de seconde zone, qui ne peuvent pas avoir recours à l’emprunt bancaire et dont les droits à commercer en dehors de la réserve sont limités. Ils sont exempts de payer des impôts et bénéficient d’aides gouvernementales.
Par voie de traités, certaines communautés ont obtenu plus d’autonomie, tout en restant sous contrôle fédéral et dépendant toujours du Ministère des Affaires Autochtones et du Développement du Nord du Canada. L’État conserve ainsi un droit de véto sur les décisions prises par les conseils de bande ou les conseils de communauté.
Wemotaci : la guérison au jour le jour
Depuis une heure, ça n’en finit pas. Derrière la vitre de la voiture, des arbres, toujours des arbres. D’un coup, les mots « immensité » , « à perte de vue » deviennent réels, s’inscrivent dans le corps. On roule depuis six heures, avec devant les yeux, la même image d’immenses résineux, pins, épinettes, sapins, thuyas. C’est ça, le Canada, avec sa forêt boréale qui fait régulièrement la une de magazines de voyages. Cent quinze kilomètres de piste depuis la ville de la Tuque. C’est le début de l’été indien. La poussière colle aux vitres de la voiture. On doit garder les vitres fermées.
Tiens, un autre… il faut bloquer l’entrée d’air. Le camion nous dépasse. Les immenses troncs d’arbres apparaissent, à l’horizontale cette fois. Le camion disparait dans un nuage de poussière. Un autre camion sort d’un chemin forestier, une artère qui laisse entrevoir que le défilé d’arbres le long de la route n’est qu’un rideau. Derrière, c’est la coupe à blanc. Le Canada détient le triste record du pays où l’on coupe le plus d’arbres, devant la Russie et le Brésil. Il est responsable de la perte de 20% de la forêt à l’échelle planétaire.
Au bout du pont, enfin, la réserve amérindienne de Wemotaci, où va avoir lieu pendant deux jours le Pow Wow annuel, une fête qui permet aux autochtones de s’enraciner à nouveau dans leur culture et leur territoire, eux coupés à blanc depuis quatre siècles. Ici aussi, une triste réalité se cache derrière le rideau des maisons alignées le long de la route. Une réalité partagée par toutes les communautés autochtones du Canada : alcoolisme, violence familiale, toxicomanie, prostitution infantile, inceste. Les habitations sont le plus souvent surpeuplées, un couple vivant avec ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs.

Wemotaci est l’une des trois réserves de la Nation Atikamekw, l’une des onze Nations amérindiennes du Québec. Cette réserve de trente-deux kilomètres carrés se situe à quatre cents kilomètres au nord de Montréal, au Québec. Enfin pas tout à fait… Les réserves amérindiennes sont territoire fédéral. Nous sommes donc officiellement au Canada, mais dans aucune province en particulier.
Ici pas de passage piéton, tout le monde circule en voiture. Le panneau de circulation ARRÊT est doublé du mot atikamekw NAKAPARI. C’est la fin de l’après-midi. Des groupes de jeunes reviennent de l’école, iphone dans la main. Les garçons sont habillés en tenue de sport, les filles portent des vêtements serrés. D’autres groupes sortent de la seule épicerie du village en faisant claquer le sac de chips et pchitter la canette de soda. Dans un coin, des silhouettes d’hommes courbés assis dans la poussière, une canette de bière à la main. Pas de femmes, pas de promenade familiale. Il y a quelque chose de différent, comme un ciel un peu plus bas qu’ailleurs.
La voiture me laisse. Je dois me rendre sur le site de l’ancienne réserve, où se tiendra le Pow Wow annuel. Une voiture me prend en stop. C’est un couple atikamekw. Je m’assois près de leur enfant de huit ans qui tend à sa mère sa canette vide de Pepsi et en ouvre une autre. Je leur demande où ils vivent. Ils me racontent sans complexe être allés vivre en ville pour se soigner de l’alcool et de la toxicomanie. La femme a fait trois fausses couches. Aujourd’hui l’homme est à la recherche d’un emploi, car, dit-il : « J’ai pas fait tout ça pour dépendre de l’État. Je veux travailler ». Tout ceci a été déballé en moins de dix minutes. Je suis étonnée de la facilité avec laquelle ils abordent ces sujets sensibles.
La réponse, je la trouverai au bout de mon séjour. C’est qu’au village, la guérison a commencé, et que les gens sont fiers de dire qu’ils sont en processus de guérison. La maison des jeunes en est l’un des principaux organes. Mise sur pied il y a dix ans, elle est gérée depuis un an par Clode Jalette. Une blanche aux yeux pétillants, avec un voile dans la gorge, qui en impose par son charisme et son énergie. Clode bouscule, tout en respectant. « Ici le temps est différent. Par exemple, les Atikamekws n’ont pas l’habitude de répondre tout de suite à une question. Le rythme de leur langue est plus lent, ils respectent beaucoup les mots. Certains croient qu’ils ne comprennent pas ce qu’on leur dit. Pas du tout. Ils vivent juste dans leur temps, et il faut le respecter. Parfois c’est difficile, pour planifier les activités de la maison des jeunes par exemple. Il faut toujours trouver le bon équilibre. C’est vraiment un échange interculturel. »

Comme les enseignants et les intervenants sociaux, Clode négocie en permanence l’équilibre entre la nécessité d’un changement et celle de garder un lien avec les traditions culturelles. Derrière la maison des jeunes, elle a créé un jardin communautaire pour initier les adolescents à manger des légumes. Car dans l’unique épicerie du village, le rayon légumes est minuscule et les légumes sont vendus très chers, contrairement aux sacs de chips, friandises, pizzas congelées et autres délices nord-américains. Le taux d’obésité et de maladies cardio-vasculaires parmi les autochtones est particulièrement élevé, touchant un tiers de la population vivant dans les réserves[iv].
Cette année, grâce à Clode, trois artistes autochtones de renommée mondiale viendront aider les jeunes à réaliser une fresque murale et des totems représentant leur attachement aux symboles traditionnels de leur culture. « Peu importe ce qu’on fait, ce qui est essentiel, c’est de travailler en jumelage. Tu ne peux pas débarquer ici, faire le Blanc qui va sauver les autochtones, et repartir. Il faut travailler avec eux ». Clode a formé une jeune Atikamewk du village qui travaille à la maison des jeunes et qui reprendra le flambeau bientôt. Aujourd’hui, une vingtaine de jeunes filles originaires de la réserve sont formées en éducation à l’enfance. Elles sont employées sur la réserve et dans des villes.
Wemotaci est aussi pionnier dans la création du Service d’Intervention d’Autorité Atikamekw, une instance qui se penche sur les situations où la sécurité de l’enfant est compromise. C’est ici que Clode a fait ses débuts à la réserve. Le SIAA travaille en collaboration avec le Conseil de Famille et le Conseil des Sages. C’est à ce niveau local que 90% des situations sont réglées.
En revenant du site de l’ancienne réserve, je cherche Hélène Collin, réalisatrice belge, qui fréquente la réserve depuis un an. Je la retrouve dans la cuisine de l’école, en train de montrer à un jeune ce qu’est le kale, un chou frisé, avec lequel elle va faire des chips. Hélène a bien compris que c’est par les petits gestes que se fera le changement. Elle a lancé un projet de jumelage avec la ville de Namur, en Belgique.
À l’école, les enseignants aussi notent un changement : « Dans ma classe, les jeunes veulent être médecins, ingénieurs, chercheurs. Ils ont de grandes ambitions », confie Najat, professeur de mathématiques d’origine tunisienne. « Un tiers des enfants fréquente l’école, ce qui est un bon taux pour une réserve. »
Si l’autogestion des autochtones progresse, elle entre aussi en contradiction avec la Loi sur les Indiens qui repose sur l’infantilisation des autochtones. Clode connaît les limites que cette loi impose : « On travaille à tous les niveaux, mais il manque encore un maillon. Le conseil de bande, celui qui a les sous. ». Le conseil de bande, élu par les communautés, est formé de fonctionnaires qui appliquent les directives du ministère. À terme, le Canada aura à gérer la contradiction entre la réalité du terrain et le maintien de lois et de statuts hérités du XIXe siècle qui assujettissent les autochtones.
Entre mémoire et renouveau : le combat d’un peuple
Les autochtones sont à un moment charnière de leur histoire. La sédentarisation des Atikamekws a été très tardive. À Wemotaci, c’est en 1972 que les habitants ont définitivement quitté leur mode de vie semi-nomade, pour venir vivre au village. Alors que dans d’autres nations autochtones, la mémoire de ce mode de vie a disparu, chez les Atikamekws, deux générations la partagent encore. Jacques Newashish, artiste natif de la réserve, se souvient : « J’ai grandi dans un tipi, on campait ici, tout autour. On vivait de la chasse et de la cueillette. Je ne me souviens pas avoir eu froid, avoir été dans la misère. On vivait tous ensemble, avec les grands-parents et la famille élargie. Notre aire de jeu, c’était la forêt. On s’entraidait aussi. Si quelqu’un manquait de nourriture ou de peaux, on allait lui en donner. » Jacques est l’une des figures marquantes de sa communauté. Arraché à sa famille pour être envoyé dans un pensionnat à l’âge de six ans, c’est dans la peinture qu’il cherche la paix. Il négocie le difficile passage entre deux modes de vie, peignant des œuvres contemporaines à l’acrylique qui transmettent des éléments fondateurs de sa culture.
La génération de Jacques a subi de plein fouet les derniers assauts de la politique d’assimilation du Canada : sédentarisation massive, discrimination faisant perdre aux femmes ayant épousé un Blanc leur statut d’autochtone, non reconnaissance des Métis, conversion au catholicisme. Les enfants envoyés dans les pensionnats ont subi, en plus de l’interdiction de parler leur langue, des sévices sexuels et des violences. Aujourd’hui, beaucoup de ceux qui ont connu les pensionnats retournent contre eux-mêmes et contre leurs enfants une violence qui n’est pas encore apaisée.

En juin dernier, après six ans de recherche et de récolte de témoignages, la Commission Vérité et Réconciliation du Canada a remis son rapport final, qualifiant de génocide culturel les sévices subis par les autochtones de 1890 à 1996 dans les pensionnats catholiques[v].
La dernière génération doit se construire entre l’héritage douloureux du génocide culturel vécu par leurs ainés, la nécessité de préserver la mémoire et les savoirs ancestraux, et celle de s’inventer une manière de vivre dans le monde des nouvelles technologies et des réseaux sociaux.
Le premier soir du Pow Wow, sur le site de l’ancienne réserve, je rencontre Makouli, un garçon de treize ans qui vit à Obedjiwan, une autre réserve Atikamekw. Makouli regarde souvent le ciel. Il cherche une étoile filante. Je lui demande ce qu’il ferait comme vœu s’il en voyait une : « Je demanderai à revoir mon grand-père ». Son grand-père est présent dans tout ce que Makouli raconte. Plus tard il veut devenir chirurgien, pour pouvoir remplacer les organes malades, car son grand-père est mort d’un cancer des poumons. Makouli raconte la fierté que ressentait son grand-père à son égard: « J’ai tué mon premier orignal quand j’avais dix ans. J’étais parti avec mon père, j’avais tellement peur, je tremblais en tenant le fusil. Puis j’ai tiré. Mon père m’a dit que c’était à moi de le dépecer car c’était mon orignal. Je n’avais jamais fait ça, ça sentait fort, je croyais que j’allais m’évanouir. On est rentrés à trois heures du matin. Mon grand-père m’a dit qu’il n’avait jamais vu un enfant de dix ans tuer un orignal. Avant de mourir il m’a dit qu’un jour, je serai gardien du territoire. Je sais que je devrai aller en ville pour devenir médecin, mais je reviendrai pour défendre mon territoire. Je ne le laisserai jamais aux compagnies forestières. »
Autochtones / Allochtones : au-delà des catégories
Dans le combat quotidien que mènent intervenants sociaux, artistes, professeurs, policiers, pas le temps pour l’idéologie. Si certains sont venus avec quelques clichés en tête, une fois sur place et dans l’urgence du quotidien, le mythe s’efface pour laisser place à une réalité où les catégories explosent. Chacun est dans l’urgence de la survie et d’un équilibre à rétablir.
Au Pow Wow, les touristes assistent aux danses impressionnantes des hommes des onze nations. Chacun porte la coiffe propre à son peuple. Ils imitent la danse de l’oiseau, les pieds frappent le sol et remuent la poussière, les corps dessinent des courbes au rythme des tambours. La danse devient frénétique. Ce sont les jeunes qui chantent. Après cette démonstration, le chef de cérémonie annonce au micro : « Allez-y, venez danser, c’est le moment ! » Le Pow Wow alterne entre danses sacrées et danses ouvertes à tous. Un Blanc s’avance, portant un bandana noir. Il prend les mouvements des autochtones, et entre rapidement dans une danse frénétique.
Cet homme, c’est Mathieu Montminy, intervenant psychosocial. Ce fils de cultivateur québécois a l’air chez lui sur cette réserve où il n’était pourtant jamais venu. Mathieu a vécu dans les neuf régions du Québec, parmi les autochtones et les Québécois. Il a travaillé avec les Inuits pour les aider à établir les bases de leur autogestion. Les Inuits sont un peuple autochtone issu d’une autre migration que celle des Amérindiens. Ils ont leur propre région autogérée, le Nunavik. Dans son travail, Mathieu se bat pour déconstruire les clichés de part et d’autre. « Quand on me demande De quoi ils ont besoin les autochtones ? Je réponds toujours : Allez leur demander, ils le savent mieux que personne ! Souvent les autochtones m’ont demandé pourquoi ils ont un problème avec l’alcool. Ils ont intégré les idées reçues comme quoi les amérindiens auraient naturellement un penchant pour l’alcool. Je leur explique que si on prenait une population de Blancs, qu’on leur enlève leur territoire, leur mode de vie, leur langue, leur religion, et qu’ils ont accès à de l’alcool ou à des drogues, on les retrouverait dans le même état.[vi] »
Mathieu veut défaire l’opposition entre allochtones et autochtones : « Je dis souvent aux autochtones : allez voir dans les petits villages québécois qui sont en train de disparaitre, vous verrez des gens qui comme vous se battent pour la préservation de leur territoire et de leur mode de vie ».

Derrière la piste de danse, un attroupement d’enfants s’est fait sur l’herbe. Assis en tailleur, un jeune homme fabrique des cerfs en tiges de cornouiller. Les enfants se servent. À chaque fois qu’il se rend sur une réserve, Patrick Gravel ne peut pas s’empêcher d’offrir quelque chose. Avec les bénévoles de la coopérative Des forêts et des gens[vii], Patrick recrée des jardins botaniques de la flore indigène et organise des séjours de survie en forêt. Allochtones et autochtones partagent des connaissances pour vivre harmonieusement avec la nature et préserver la biodiversité. Patrick n’approche pas les autochtones pour les aider, mais pour apprendre d’eux, et pour gérer ensemble un territoire qu’il considère comme commun.
« Les gens des Premières Nations ont des cultures très riches et méconnues. Nous avons beaucoup à apprendre d’eux. Les savoir-faire ancestraux que les ainés partagent nous aident à développer des relations avec de nombreuses espèces dans l’écosystème. Les agents forestiers ne connaissent pas la richesse de la faune et de la flore des forêts. Ils n’ont pas le temps pour ça. »
La curiosité et le regard de Patrick sont des moteurs puissants de changement : cet été, il est parti pendant trois semaines vivre au cœur de la Montagne Noire, sur le territoire des Algonquins de la réserve de Kichisakik, en Abitibi. Seulement ce n’est pas auprès de la société qui gère les établissement en plein air, la SEPAQ, que Patrick est allé chercher les autorisations. C’est auprès des populations autochtones qui revendiquent ce territoire. Il s’est rendu auprès des chefs de communautés avec du castor et du tabac en offrande. Devant eux, il a reconnu le génocide, les horreurs des pensionnats, et leur a demandé l’autorisation d’aller camper pendant trois semaines sur leur territoire.
« Si on reconnaît que les autochtones n’ont jamais légué leur territoire, il est normal, lorsqu’on leur parle d’utiliser ou même de protéger ce territoire, d’entamer un dialogue et de prendre des décisions avec eux. Je crois que la reconnaissance doit se faire du bas vers le haut. Reconnaitre l’histoire, c’est le premier pas vers la guérison. C’est de la responsabilité de chacun, et c’est cela qui fera tomber les préjugés, de part et d’autre. Au début les Algonquins n’y croyaient pas, ils me prenaient pour un agent du gouvernement. J’étais très frustré, j’en ai pleuré. Ils m’ont dit qu’ils allaient réfléchir. Quelques jours plus tard, ils m’ont convoqués et ils ont acceptés. La confiance, ça prend du temps. »
Lors de ce séjour, un jeune algonquin d’une maison d’accueil les a rejoint. Patrick raconte : « Ce jeune Algonquin est parti avec nous. Au début, il me disait qu’il avait honte d’être autochtone. Au bout de cinq jours, en redécouvrant le territoire et le savoir de ses ainés, il m’a dit qu’il était fier ». Aujourd’hui, les Algonquins demandent à Patrick d’être l’intermédiaire dans leur conflit avec les compagnies forestières.
L’indien, toujours source de fantasmes
Sur leur cheveux, pas de plume. Pas de tunique en cuir. Pas de peinture faciale. Ils portent des jeans, des t-shirts et des casquettes de sport. Ils mangent principalement des burgers, des patates et chips. Ils roulent en voiture et ont tous des iphones. Certains hommes travaillent pour les compagnies forestières. On est loin de l’image d’Épinal encore véhiculée en Europe de l’indien proche de la nature. Loin aussi de l’image dégradante largement répandue au Canada comme aux USA : les autochtones sont des assistés sociaux alcooliques et délinquants. Pris entre l’image folklorisée du bon sauvage et celle du parasite de la société, les autochtones n’ont pas fini d’être sources de fantasmes et de peurs.

Deux jours avant le Pow Wow, un groupe d’écologistes débarque à Wemotaci. Ils ont prévu de faire un grand évènement rassemblant autochtones et écologistes pour créer un front commun de protection de la biodiversité. Le groupe se réunit dans la grande salle du centre communautaire. Clode encourage les jeunes à assister à la première réunion. Les chaises sont disposées en cercle, comme le veut la coutume amérindienne. En guise de cérémonie d’ouverture, des jeunes de la communauté, qui ont créé leur propre groupe, Northern Voice, entonnent un chant traditionnel autour d’un gros tambour. Les cris stridents qui sont faits pour résonner dans les collines rebondissent dans tous les coins de la salle, plusieurs se bouchent les oreilles. Sitôt la musique terminée, tous les jeunes partent. Il ne reste dans la salle que le groupe d’écologistes, et un autochtone de la communauté, Charles Coocoo, le philosophe de Wemotaci.
Charles prend la parole. Il la gardera pendant près d’une heure. Il raconte un mythe amérindien, et la pratique ancestrale d’enterrer le placenta de la femme accouchée. « C’est l’écologie profonde, qui est enracinée dans notre tradition ». Malgré la fatigue de la longue route, les écologistes écoutent avec dévotion. La Terre Mère est célébrée par la voix du Sage Indien.
Au village, certains habitants ont vu des affiches, mais n’ont pas compris de quoi il s’agissait. On s’interroge : un front commun annoncé sans les avoir consultés ? Les organisateurs ne semblent pas avoir averti la radio locale ni ceux qui travaillent au quotidien sur le terrain avec les autochtones. Au programme du groupe : tente de sudation, pow wow, réunions et prières en cercle.
De retour à Montréal, un texte exprimant l’esprit de la rencontre est publié sur la page du groupe :

« Les gens que j’ai rencontré à Wemotaci ne parlent pas le même langage que nous, que vous… Ils parlent le langage de la compassion, de l’entraide, de la non-performance, de la sensibilité, de l’amour et de l’harmonie avec la Terre-mère. Ils parlent un langage sincère, authentique, émotif. Ils parlent le langage de la communauté et non de l’individualisme, ils savent que travailler seul rend faible et qu’il faut travailler ensemble. Ils portent de belles plumes, mais ils ne portent pas de masques, eux. Mais surtout, ils parlent un langage d’équité, un langage non-hiérarchique, il n’y a pas de chef ! Ils appliquent une démocratie directe dans leurs décisions. »
Le mythe du bon sauvage hérité de Rousseau, Montaigne, Jacques Cartier ou encore Benjamin Franklin est réactivé. La diversité des cultures autochtones est effacée, au profit d’un seul type, construit en opposition à l’homme occidental, et comme sa figure idéalisée : égalitaire, démocratique, harmonieux, collectiviste, proche de la nature. Marie-Pierre Bousquet, spécialiste des Amérindiens Algonquins du Canada, a passé des années sur des réserves du Québec. Elle a été témoin des stéréotypes que beaucoup d’allochtones véhiculent : « Ils pensent en cercle, ils ont une pensée holistique, ils ont l’esprit communautaire, ils ne sont pas individualistes, ils ont une conception cyclique du temps, ils sont proches de la nature, ils ont une intense vie spirituelle, ils sont sages… Chacun de ces stéréotypes réduit à une dimension très simplifiée, donc simpliste, des cultures et des façons de voir le monde complexes[viii] » Pour l’anthropologue, c’est un phénomène qui dépasse les Amérindiens : « toujours, l’Autre sera en harmonie avec la nature ou intensément spirituel. De fait, les Amérindiens sont des sociétés à idéologie égalitaires, mais il y a toujours des hiérarchies sociales, de prestige, de pouvoir ».
Les stéréotypes sur les autochtones ont encore de beaux jours devant eux. La représentation des amérindiens du XIXe siècle domine encore dans les médias, les dessins animés et sur internet. Par l’image, on les exclut à nouveau de la société contemporaine. Alors, ils commencent à créer leurs propres sites internet, où ils se montrent avec des casquettes et des jeans, créant des designs modernes sur leurs t-shirts, animant des émissions de radio, faisant des self-vidéos.[ix]
Mais ce qui maintient surtout ces stéréotypes en vie, c’est désenchantement de nombreux Occidentaux envers leur propre culture. Alors nait le besoin de trouver un Autre idéal, qui nous sauvera. Au Canada, le néolibéralisme est particulièrement brutal. Le pillage des ressources – bois, hydrocarbures, eau – est proportionnel à l’immensité des paysages qui font encore chaque année la une des revues de voyage françaises. Au Québec, la génération du mouvement érable de 2012, du mouvement Occupy et de Idle No More[x], cherche une alternative. Parmi eux, certains trouvent dans la culture amérindienne une réponse spirituelle. La parole, les symboles et le folklore de l’amérindien est pris en dehors de tout contexte historique. Comme si l’homme rouge, lui non plus, « n’était pas encore entré dans l’Histoire ». Se considérant comme descendants des colons, ces militants viennent aussi chercher un pardon pour ce que l’Homme Blanc a fait.
Vincent Dostaler, l’un des organisateurs du forum, défend son lien aux traditionalistes : « Je ne travaille qu’avec les traditionalistes. Jamais avec ceux qui travaillent pour les compagnies forestières. Les esprits mettent des embuches pour trier les faibles. »
Le dernier jour de réunion, Vincent fait une annonce : « Certains ont pu se demander pourquoi il n’y avait pas autant d’autochtones qu’on aurait pu le croire à nos réunions. J’aimerais vous dire que parmi nous, il y a une dizaine de personnes qui viennent d’Haïti, de Panama, de Tunisie, donc il y a bien des autochtones parmi nous ».
Finalement, ce qui est autochtone est simplement ce qui n’est pas l’homme Blanc.
À quelques mètres du centre communautaire, pendant que le groupe boit de la sagesse indienne, Clode, Jacques, Najat, Hélène, Mathieu et Patrick travaillent, au jour le jour, négocient, apprivoisent, font des erreurs, remuent la vase de la réalité, débroussaillent le terrain où les autochtones devront se réinventer un chemin nouveau, enraciné et contemporain.
[i] Ministère des Affaires Autochtones et du Développement du Nord, 2011 : http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100013791/1100100013795
[ii] Loi sur les indiens (1876, 1985) : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-5/
[iii] ‘’The Indian Act : historical overview’’, Jay Makarenko, 2008 : http://mapleleafweb.com/features/the-indian-act-historical-overview#aboriginal
[iv] « Prévalence de l’obésité au sein des populations autochtones », Agence de Santé Publique du Canada, 2006. http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/oic-oac/abo-aut-fra.php
‘’Cancer chez les autochtones du Québec vivant dans les réserves et les villages nordiques, de 1984 à 2004,’’ rapport de l’INSPQ, Institut National de Santé Publique du Québec, p.35 https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/736_CancerAutochtones.pdf
‘’Nutrition et consommation alimentaire chez les Inuits du Nunavik’’, enquête de l’INSPQ, 2004 : https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/resumes_nunavik/francais/esi_nutrition.pdf
[v] Conclusion Commission Vérité et Réconciliation, Les principes de la vérité et de la réconciliation, juin 2015, p.11 http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Principes%20de%20la%20verite%20et%20de%20la%20reconciliation.pdf
[vi] « La transformation des contextes traditionnels d’usage, d’une part, et la transformation violente de la société, d’autre part, sont des facteurs qui ont indéniablement joué un rôle dans la relation que les Amérindiens de l’époque post-colombienne ont développée avec l’alcool. », Marc Perreault, ‘’Alcool et Amérindiens : au-delà des stéréotypes, Drogues, santé et société, 4, 1, 2005, p.5-13
[viii] Marie-Pierre Bousquet, « De la pensée holistique à L’Indian Time : dix stéréotypes à éviter sur les Amérindiens », Nouvelles pratiques sociales, 24, 2, dir. Denyse Côté, Isabelle Côté et Sylvie Lévesque, printemps 2012, p.204-226 http://www.erudit.org/revue/nps/2012/v24/n2/1016356ar.html?vue=resume
[ix] Leavitt, Peter A. (2015) « ‘Frozen in Time’: The Impact of Native American Media Representations on Identity and Self-Understanding”, Journal of Social Issues, vol.71, no.1, pp.39-53.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josi.12095/epdf
[x] mouvement de protestation autochtone né en décembre 2012 suite à la loi omnibus C-45 du gouvernement Harper, qui violait plusieurs traités ancestraux des droits fondamentaux des autochtones



 English
English Español
Español