Dans l’émergence du mouvement des Gilets Jaunes, une opposition entre deux urgences s’est dessinée entre l’écologie et le social. L’une serait un luxe, l’autre une nécessité. Dans ce faux débat, on entend et on lit « Il est plus facile d’être écolo, de manger bio, quand on est à Paris »[1]. Penser à son empreinte écologique, c’est pour ceux qui n’ont pas à se soucier de remplir leur frigo, qui peuvent se payer des voitures électriques et acheter des produits bio hors de prix, et qui ont le temps d’y penser. Les autres sont la tête dans le guidon et dans la survie. Cette vision binaire est non seulement loin de la réalité, toujours plus complexe, mais elle hypothèque notre avenir et nous enlise dans une confrontation stérile où nous y perdrons tous, à commencer par les plus démunis, premières victimes de la disparition de la biodiversité et du réchauffement climatique. À l’heure où nous avons besoin plus que jamais d’additionner nos intelligences pour envisager une autre société, pourrait-on envisager autrement la révolte et le débat en France ?
DOSSIER EN TROIS PARTIES :
- Le pauvre écolo existe
- La représentation qu’on se fait du monde : le rôle des médias
- Les oppositions binaires : un délice français
1. LE PAUVRE ÉCOLO EXISTE
Les Gilets Jaunes réagissent à l’entourloupe qui consiste à taxer le prix du carburant pour les plus modestes sans accompagnement social, alors même que des revenus de la taxe carbone, 577 millions d’euros seront transférés du budget de l’écologie au budget général[2]. Si une mesure dissuasive contre le carburant le plus dangereux est nécessaire, elle ne paraît plus légitime dès qu’elle s’inscrit dans une politique fiscale qui pénalise les plus démunis. Il s’agit donc d’une injustice sociale qui prend en otage la question écologique, alors même que la suppression du diésel est avant tout une question de santé publique, c’est à dire touchant au moyen terme les individus. Pas de chance pour la question écologique, les Français ne se sont pas autant mobilisés contre d’autres mesures fiscales. Bonne mesure arrivée dans un mauvais contexte ? Nouvel impôt déguisé pour renflouer les caisses ? Dans les deux cas, la fausse opposition qui en sort entre l’urgence écologique et l’urgence sociale fera bien des dégâts. Elle fait ressortir à quel point la question écologique est mal posée en France. Car en réalité, il n’y a pas de choix à faire entre l’avenir de notre planète et notre avenir immédiat.
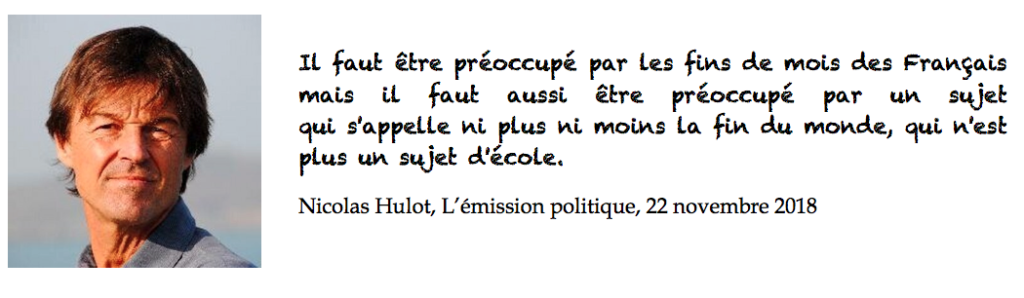
Quand ça revient moins cher d’être écolo
Samedi, jour de grand marché dans une petite ville de l’un des départements les plus pauvres de France. Au rond-point ça ralentit, les gilets jaunes sont là. Un camion transportant des produits bio prend le temps de s’arrêter et d’ouvrir la fenêtre pour leur parler. Pour livrer ses produits bio, il parcourt des milliers de kilomètres par an, et son camion n’est ni électrique ni hybride. Personne ne klaxonne. En montagne on a l’habitude de s’arrêter sur la route pour parler à des voisins.
Ici chaque semaine, tous les montagnards des vallées alentour se retrouvent. Pour faire leurs courses, ils ont fait entre quinze et quarante cinq minutes de voiture, aller puis retour. Ici pour aller chercher du bois, pour amener les enfants à l’école, pour rejoindre un départ de piste de parapente ou de randonnée, pour aller chercher des cigarettes ou du pain, un seul mode de transport possible : la voiture. Les pneus d’hiver sont mis. Ça coûte une blinde, mais personne ne joue avec la sécurité en montagne. Bientôt les cols seront inaccessibles et il faudra faire un détour pour se rendre en ville. On essaye toujours de concentrer toutes les commissions pour éviter les trajets : remplir le frigo, poster des lettres, acheter des douilles pour finir le meuble, changer les livres des enfants à la bibliothèque… En partant on demande au voisin s’il a besoin de quelque chose, on propose du covoiturage aux voisins. Certains font du stop, on les prend facilement. La montagne, ça rend solidaire. Le reste de la semaine, on ne dépense pour ainsi dire rien. Ni sandwich ni café ni petite babiole. En montagne, on ne manipule pas souvent l’argent. Pour chacun, le budget transport est le plus élevé. On compense par le fait de très peu consommer par ailleurs. En ce moment on s’affaire pour rentrer le bois avant les premières neiges, on débroussaille une dernière fois avant le printemps, on range les conserves qui feront tenir l’hiver, on se dépêche de finir le toit d’une vieille grange ou de poser un carrelage récupéré au rabais. Et puis chacun vaque à ses activités : les ouvriers à leurs chantiers, les écrivains à leurs manuscrits, les employés à l’école, au café du village, à l’hôpital de la ville voisine, les agriculteurs dans leurs champs, les éleveurs à leurs troupeaux. Les saisonniers attendent la neige et les premiers touristes. Tous pauvres, chacun à sa manière, sur un même territoire.

Ce département fait partie des quinze plus pauvres de la métropole. 18,5%[3] vit en-dessous du seuil de pauvreté, c’est à dire avec moins de 840 € par mois, les allocataires de minima sociaux sont en augmentation, les demandeurs d’emplois aussi, chez les jeunes comme chez les seniors. Pourtant même ceux qui squattent de vieux campings-car en attendant de trouver un logement, on les retrouve au magasin bio du coin. On achète les carottes à 3€ le kilo, mais on fabrique nos meubles avec des chutes de bois récupérées. Dans les placards sous les éviers – pas d’Ikea s’il vous plaît –on trouve du vinaigre blanc (1 € la bouteille), du bicarbonate de soude (2€ le kg) et du savon noir (4 € le Litre). Avec ça, on en a pour six mois de nettoyage de toute la maison. On déchire des tissus plutôt que d’acheter des chiffons jetables, on met une assiette plutôt que d’acheter du cellophane pour couvrir les plats, on fait des confitures et des compotes avec les fruits qu’on ramasse sur les chemins, on plante des légumes.

Dudule vit en montagne. Il a fait tous les boulots du monde : secouriste de montagne, maçon, moniteur de parapente. Autant dire que sa retraite est mince. Il y deux ans, il a construit sa maison avec un toit végétal, un mur enterré et de grandes vitres. Il se chauffe par énergie passive. Il n’a presque pas besoin de mettre du bois. La maison où il a vécu pendant vingt ans est louée par Mélanie et sa fille Daria. Mélanie est mère seule, la quarantaine, petits boulots, RSA. On les retrouve souvent à la Biocoop. Elles font des conserves avec les fruits locaux, les troquent contre d’autres denrées. Daria va souvent jouer avec Darius, le fils de Julien, ouvrier et Sandrine, infirmière. Ils vivent dans un camping car en attendant de construire leur maison sur un terrain qu’ils ont acheté pour une bouchée de pain. Leur but : être le plus autonome possible énergétiquement et faire de la permaculture pour couvrir une bonne partie de leurs besoins alimentaires. En attendant ils complètent leur alimentation par des plantes sauvages. Ils ont appris avec Sonia et Patrick, qui proposent des ballades pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages : orties, pissenlits, feuilles de ronce. Ça ne coûte rien. Sur ce flanc de montagne, agriculteurs, enseignants, ouvriers, infirmiers, sans emplois, artistes, bûcherons, cultivent leur pauvreté en harmonie avec le vivant.

Deux pauvres au supermarché
Ce samedi, après avoir fait les poubelles du marché, Sacha passe au magasin bio prendre les fruits et légumes abîmés, histoire de se faire un jus dans son petit mixeur acheté à 10 € sur Leboncoin. Claude est là aussi, et s’achète pour 15 € de fruits exotiques et de fraises pour faire des jus dans sa centrifugeuse achetée 150 €. Sacha passe ensuite au supermarché acheter du vinaigre blanc et demander au boucher des os, officiellement pour ses chiens, en réalité pour faire du bouillon qui lui durera toute la semaine. Puis se dirige vers la caisse. Sur le tapis roulant juste devant, Dominique a posé ses articles : jambon sous vide à 2,49 € les 4 tranches, bouillon de bœuf en cubes à 18 € le kilo, trois produits ménagers, un pour le sol, un pour la salle de bain, un pour la cuisine, à environ 2 € l’unité, jus de fruits à 3,62 € la bouteille. Pauvres, ils le sont tous les deux. Pourtant nul doute sur le fait que Dominique paye plus cher ses dîners et son entretien ménager. Peut-être qu’il a moins de temps que Sacha. Le temps de verser de l’eau sur des os et d’allumer le gaz, de mélanger bicarbonate et vinaigre dans un pchitt, de couper des fruits de saison et d’appuyer sur le bouton du mixeur… Non, c’est sans doute autre chose qui les sépare, qui n’a rien à voir avec leur pouvoir d’achat.
Riches et pauvres, tous
enfants de la consommation

La richesse et la pauvreté ne sont pas des modes de vie. Ce sont des territoires qui délimitent l’espace au sein duquel nous faisons des choix et où nous ordonnons nos priorités. Ce qui définit notre mode de vie, c’est un rapport au monde, forgé par des valeurs, des priorités, des choix, des renoncements, savoir ce qu’on veut et ce qu’on ne veut pas, et l’articulation que nous faisons entre notre individualité et ce à quoi nous participons. De là découle la manière dont nous mangeons, dont nous allons voir des spectacles ou achetons nos vêtements. Certains pauvres achèteront des baskets à 30 € qu’ils changeront au bout d’un an, d’autres pauvres mettront 100 € dans une paire de bonnes chaussures de marche qu’ils garderont dix ans. Certains riches installeront des radiateurs électriques dans toutes les pièces de leur villa, d’autres installeront des systèmes photovoltaïques[4].Nous sommes tous les enfants d’une société de consommation où, d’un bout à l’autre de la chaîne, du plus riche au plus pauvre, nous voulons continuer à consommer de la même manière. Les uns iront acheter les fraises bio à 291,67 € le kilo, les autres les fraises d’Espagne à 1,95 € la barquette. Or ce qu’on appelle la transition écologique ne sera efficace que si elle s’inscrit dans un changement de société. Et un changement de société n’est pas qu’un changement de comportements. C’est un changement culturel. Un changement de paradigmes, de valeurs, de priorités, de rapport à ce qui nous entoure. Il est sans doute plus facile de bien manger quand on a de l’argent. Mais quand on n’en n’a pas, il n’est pas plus difficile de manger sainement que de mal manger.
Manger de façon écoresponsable, ce n’est pas manger de la même manière en achetant plus cher. C’est manger autrement. Une assiette de pâtes de farine complète nourrit plus que deux assiettes de pâtes de farine blanche. On mange moins et on est mieux rassasié. Ajouter soi-même des fruits secs à ses flocons de maïs en vrac revient moins cher que d’acheter un paquet de Kellogg’s Extra Fruit. De plus en plus de gens passés aux laits végétaux sont sujets à des ballonnements, excès de graisse et de sucre, car ils en consomment une seule sorte et en même quantité que le lait de vache qu’ils prenaient avant. Ces boissons devraient être consommées en petites quantité et surtout en variété. Deux éléments étrangers au principe de la consommation, qui nous encourage à manger peu varié et en grosse quantité. Nous sommes donc poussés au verdissement des comportements comme le dit le sociologue Jean-Baptiste Comby

« C’est plus rapide, j’ai pas le temps ». Aller vite est un des grands principes de la consommation, et fait partie d’un engrenage bien huilé : partir au boulot, rentrer épuisé chez soi, aller au plus facile, donc acheter plus cher, s’affaler devant la télé, s’endormir sur le canapé, et le lendemain partir travailler pour payer nos factures et financer ces dépenses qu’on pourrait pourtant réduire. Mais où creuser la brèche ? À bien regarder le temps que l’on passe à choisir des produits dont on pourrait se passer, à racheter des produits vite consommés, il n’est pas si sûr que les écolos aient plus de temps que les autres.

L’écologie n’appartient pas aux bobos
Si le discours sur l’écologie est accaparé par les élites, sa pratique ne leur est pas réservée. Il est urgent de décloisonner cette thématique. Écolo est devenu un statut social qui culmine dans la figure du bobo[5]. Celui qui roule en voiture automatique ou à vélo électrique, qui achète à midi une salade bio à 14 euros et qui va dans les magasins où le petit panier de tomates cerises coûte 4 €. Une vision largement entretenue par les médias et les détenteurs de la parole publique, et sans doute bonne à avaler pour ceux qui ne souhaitent pas remettre en question leurs habitudes.
Le transport est sans doute l’un des éléments que nous maîtrisons le moins. Nous ne contrôlons pas le prix de l’essence, ni l’accessibilité des moyens de transport. Mais emprisonner la légitime indignation contre une politique fiscale injuste dans une opposition entre écolos et pauvres, est une facilité bien loin des réalités. Elle crée de beaux titres de plateaux télé, mais ne fait qu’entretenir un mythe qui nous empêche d’entrevoir un changement de société auquel chacun est appelé à répondre, pour sa propre survie et celle de ses enfants.
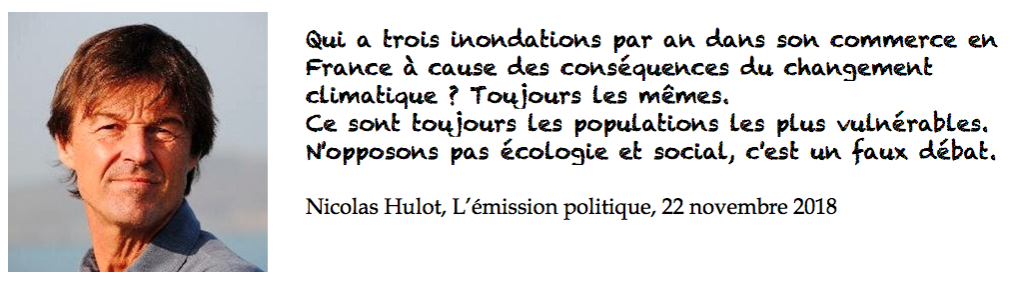
La suite prochainement : Le rôle des médias
[1] Christophe Guilly https://www.20minutes.fr/societe/2375331-20181119-gilets-jaunes-geographe-christophe-guilluy-france-haut-fait-secession-france-bas?fbclid=IwAR2iGlhiWUirhNC3gX_S_2BMn2ZLhN34dEhv4SqQM_0j57pWO19gv4khP5M
[2] https://www.publicsenat.fr/article/politique/taxe-sur-les-carburants-en-2018-le-gouvernement-transfere-577-millions-d-euros-du
[3] http://www.linternaute.com/ville/ariege/departement-09
[4] « Manger bio, refaire l’isolation de son logement, opter pour un fournisseur d’énergie alternatif, ne vivre que du tout recyclable et des marques écoresponsables: pour beaucoup, l’écologie est un sport par et pour les riches. Pourtant, en adoptant une démarche écoresponsable, il y a surtout des économies à la clé. Pour cela, il faut être malin, patient et persévérant. » http://www.slate.fr/story/113153/vivre-ecolo-prix



 English
English Español
Español