Ma toute petite,
Je t’écris ce soir comme on se penche sur une plante qu’on n’avait pas vu pousser dans un coin du jardin où on ne se rend jamais. Comme on découvre un bijou oublié. Pour te dire que l’orage est passé, et que tu peux sortir maintenant.
Il y a si longtemps qu’on ne s’est pas assises toi et moi au coin de quelque chose qui nous réchauffe. Toi la petite ouvrière dans l’arrière-boutique de l’humain. Celle qui ne vient jamais au comptoir. Celle qu’on n’expose pas en vitrine, mais qui se tient derrière les sourires, derrière la puissance, les opinions et la volonté. Derrière tout ce qui attire.
Moi aussi j’ai appris à te laisser en coulisses. Je te sens bien t’agiter avant chaque spectacle, mais je ne t’emmène pas dans la lumière. Sur scène, il faut assurer. Peu importe la fatigue, le siège bancal, le son qui craint, la salle aux trois quarts vide. Peu importent les tourments de ma petite vie privée. Je les récupérerai à la sortie.
Depuis quelques temps, j’essaye de t’emmener quand même avec moi en sortie. Montrer au lecteurs, au public, l’arrière-scène de ce métier qui est le mien. Donner à voir les doutes, les incompréhensions, les coups de gueule. Solliciter des avis, du soutien, des initiatives. Pas pour servir ma gloire. Juste pour que les textes qui passent par moi vivent.
Rares sont ceux qui ont su voir ton ombre accrochée à moi. Encore plus rares ceux qui ont su l’accueillir. Lui offrir un refuge pour quelques heures. Voir en moi ce qui appelle derrière ce qui décrète. Je passe pourtant ma vie à le voir chez les autres. Partout je guette les entre-deux, les choses en train de se faire, les potentiels qui essayent de passer le seuil du réel. J’ai toujours aimé les boulangeries où on voit les artisans du pain pétrir la pâte. J’aime les heures où la ville se prépare : le bureau de poste qui trie le courrier la nuit, la première lettre glissée dans la fente, la première pile de journaux fraîchement imprimée qui arrive au kiosque, le premier coup de balai des éboueurs. Aux terrasses des cafés j’aime me poser et regarder les passants et les enterrassés. Je guette ce qu’ils fuient, ce qu’ils cachent, ce qu’ils cherchent à faire oublier.
C’est là mon geste : déplier les potentiels, donner aux possibles la seule nourriture que je sais faire pousser : les mots. Les pauvres petits mots du quotidien, cette matière que tout le monde possède déjà et que l’écrivain taille pour en faire de la musique, ou une vague imitation. Je me rends compte que j’ai choisi la matière la plus fragile. Celle qui se travaille sans outils, sans instruments, sans atelier pour s’isoler. Qui n’a qu’un stylo et l’espace d’une feuille de papier pour s’arracher au monde.
Ce soir j’ai soudainement envie de répondre à ton invitation. J’y réponds comme tout le monde répond aujourd’hui : quand je peux, c’est-à-dire bien trop tard. Peut-être d’ailleurs as-tu oublié que tu es un appel. Appel à l’abandon pour les hommes à qui on demande d’être forts, entraînants, protecteurs, drôles. Pour les femmes à qui on exige d’être amante séductrice, carriériste impitoyable, mère tendre, gestionnaire du foyer et fille fidèle.
Je réclame que les hommes aient le droit d’être maladroits sans se faire traiter de salauds. Qu’ils aient le droit de douter sans se faire traiter d’immatures. Des hommes qui embrassent leur liberté sans se faire traiter d’irresponsables. Qui pleurent entre les bras d’une femme sans avoir peur d’être faibles. Je réclame des femmes qui puissent déposer leurs armes et se faire encore respecter, qui puissent se protéger sans avoir besoin de se renier. Qui apprennent à parler aux hommes sans y voir l’ennemi. Des femmes que l’on puisse regarder avec des yeux qui ne prétendent pas savoir ce qu’est une femme. Des hommes et des femmes qui s’approcheraient vierges de tout a priori sur ce qu’est l’autre.
Je réclame des hommes et des femmes qui te porteraient en médaillon et t’entendraient teinter en s’enlaçant. Réapprendre à faire confiance à quelqu’un, même pour un temps. Dégrafer les postures. Se déposer, comme le comédien qui ne surjoue pas s’offre au public. Disponible. Comme le corps qui se relâche sous les doigts du praticien. S’offrir une chance d’être entier, quelque part sur un quai oublié de ce monde de postures de remplissage et d’informations. Et apprendre à accueillir celui qui nous approche ainsi. Car rien n’est plus puissant qu’une fragilité qui se laisse voir, puisque c’est par là que la lumière passe.
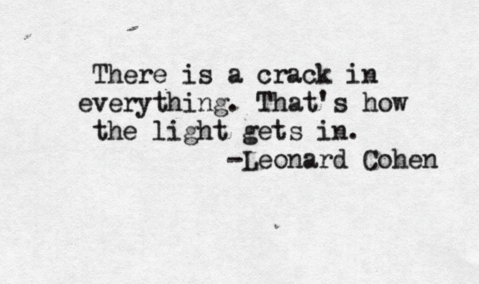
Sarah Roubato a publié :

Chroniques de terrasse
À différentes terrasses d’une ville, un narrateur anonyme observe du matin à la nuit le flot des passants et les scènes qui se jouent. Depuis son petit coin de trottoir, il est le témoin d’une société et d’une époque que racontent des personnages qui ne durent que le temps d’un verre.
Cliquez ici pour acheter ce livre sonore

30 ans dans une heure
Partout en France et ailleurs, ils sont sur le point d’avoir trente ans. Une foule d’anonymes qui cherchent à habiter le monde ou à le fuir, à dessiner leurs rêves ou à s’en détourner. Au cœur du tumulte, ils s’interrogent, se font violence et ce sont leurs voix que l’on entend se déployer
Cliquez ici pour le commander chez l’éditeur
Lettres à ma génération
Un recueil de lettres adressées à toutes celles et ceux, même s’ils ne peuvent pas répondre, qui peuplent la solitude d’une jeune femme éprise de la beauté du monde. Comment la dire, comment la préserver, comment y participer, alors que des forces contraires – l’hyperconsommation, les renoncements politiques, l’ambivalence du progrès technologique – nous isolent toujours plus les uns des autres ?
Cliquez ici pour en savoir plus et lire des extraits. Cliquez sur le livre pour le commander directement chez l’éditeur ou commandez-le dans n’importe quelle librairie



 English
English Español
Español


Et quand la fragilité trouve les mots pour se dire…on mesure sa force. Lentement sur la pointe des pieds, en lisant ta lettre, je la hisse sur mon cœur. MERCI Sarah de t’adresser à ma part qui crie si fort. J’honore la tienne..