Quand les petites impressions révèlent les grandes questions… voici quelques scènes récoltées en parcourant une France qui ne se montre ni dans les journaux ni sur les guides touristiques, et qui nous racontent quelque chose sur l’humain auquel nous participons, et celui qu’il nous reste à inventer.
C’est un village quelque part entre montagnes, lacs et forêt. Les prés bordés des couleurs d’automne invitent encore à la sieste après le repas. Un seul besoin m’habite : la marche et le silence. Elle me propose de m’accompagner. Je préfère être seule, mais son regard franc et calme finit par me convaincre. Nous suivons un chemin qui passe à travers prés, enjambons des clôtures. Nous passons près d’un charme. J’aimerais m’y arrêter. Dommage. Je repère le chemin mais je l’ai vite oublié. Plus loin nous rejoignons un chemin doré. Les couleurs n’ont rien à envier au pastel de Mary Poppins. Elle me fait passer encore sous une clôture, s’arrête en plein milieu du pré, me tend le bras et dit « Tu me fais confiance ? »
 Je prends son bras, ferme les yeux et me laisse guider. Je lis le paysage par les pieds. Une sensation que je n’ai connue qu’une fois, dans le Haut Atlas. Première arrivée au village où j’allais retourner treize fois. C’était une nuit sans lune. Après cinq heures de route et de pistes par la montagne, le camion arrive en pleine nuit dans un village. Les mules sont chargées et partent en avant. Je ne trouve pas ma lampe. Personne n’est habillé en blanc. Tant pis. Il faut marcher. Je n’ai plus que mes pieds pour comprendre où je suis. Les chemins qui descendent, les cailloux qui glissent, puis la terre boueuse, les bouts de bois qui nous font traverser la rivière, la remontée, petite glissade sur un bout de glace, et puis un interminable chemin. Suis-je en plein milieu d’un champ ou d’une forêt ? Est-ce qu’en tendant le bras je vais toucher le mur d’une maison ? Je n’en n’ai aucune idée. Soudain mes pas craquent. Castagnent plutôt. Je me demande sur quoi je marche. C’est au matin que je découvrirai que ce sont des centaines de kilos de coquilles de noix que les femmes jettent devant leur maison après les avoir décortiquées.
Je prends son bras, ferme les yeux et me laisse guider. Je lis le paysage par les pieds. Une sensation que je n’ai connue qu’une fois, dans le Haut Atlas. Première arrivée au village où j’allais retourner treize fois. C’était une nuit sans lune. Après cinq heures de route et de pistes par la montagne, le camion arrive en pleine nuit dans un village. Les mules sont chargées et partent en avant. Je ne trouve pas ma lampe. Personne n’est habillé en blanc. Tant pis. Il faut marcher. Je n’ai plus que mes pieds pour comprendre où je suis. Les chemins qui descendent, les cailloux qui glissent, puis la terre boueuse, les bouts de bois qui nous font traverser la rivière, la remontée, petite glissade sur un bout de glace, et puis un interminable chemin. Suis-je en plein milieu d’un champ ou d’une forêt ? Est-ce qu’en tendant le bras je vais toucher le mur d’une maison ? Je n’en n’ai aucune idée. Soudain mes pas craquent. Castagnent plutôt. Je me demande sur quoi je marche. C’est au matin que je découvrirai que ce sont des centaines de kilos de coquilles de noix que les femmes jettent devant leur maison après les avoir décortiquées.
Depuis quelques minutes, je me laisse envelopper par un bras qui me soutient et me guide. Je retrouve un lien au monde par le toucher. Ce sens tellement sous-développé dans notre société dominée par la vue. Je n’aime pas faire la bise. Un coup de joue ne m’a jamais fait entrer en contact avec quelqu’un. Mais serrer une main… Mes yeux clos perçoivent un changement de lumière. L’air est plus vif. Elle me dit qu’on va descendre quelques marches. J’entends que je ne marche plus sur l’herbe. Puis : « C’est quand tu veux. »
 J’ouvre les yeux. Je suis à pic au bord d’une falaise, devant des montagnes bleutées par les dernières heures du jour. Il ne reste plus rien des prés, des clôtures, des vaches, du cocon végétal. À quelques mètres, c’est la roche découpée, la majesté des sommets rassurants et la profondeur de l’eau, tout ça à mes pieds.
J’ouvre les yeux. Je suis à pic au bord d’une falaise, devant des montagnes bleutées par les dernières heures du jour. Il ne reste plus rien des prés, des clôtures, des vaches, du cocon végétal. À quelques mètres, c’est la roche découpée, la majesté des sommets rassurants et la profondeur de l’eau, tout ça à mes pieds.
Un couple vient vers nous. Le point de vue est connu des touristes. Ils sont arrivés par la route qui serpente entre les montagnes. On peut s’arrêter sur les accotements pour admirer la majesté des falaises qui plongent dans le lac. Tout est annoncé. On se prépare au grandiose.
Moi j’ai eu le privilège d’arriver par l’autre route. D’une campagne cocoonante, généreuse et calme. De la tranquillité des prés, des arbres fantaisistes. C’est ce coin de campagne qui m’a révélé la majesté des montagnes.
Dans notre société où il faut tracer un chemin droit, sûr, planifié, où le plus court chemin sera toujours salué, où les opinions se forgent sur des images qui affichent les résultats mais non les processus, il est parfois salutaire de se demander d’où vient le regard que nous posons sur les choses. De soulever nos pieds pour humer la terre qui reste accrochée à nos souliers. C’est peut-être dans le regard de ceux qui foulent des réalités contrastées que se logent les paysages les plus grandioses.

Sarah Roubato a publié
Trouve le verbe de ta vie ed La Nage de l’Ourse. Cliquez ici pour en savoir plus. Cliquez sur le livre pour le commander chez l’éditeur.
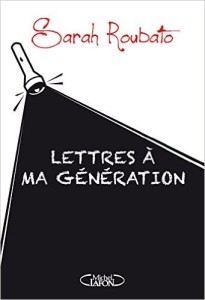 Lettres à ma génération ed Michel Lafon. Cliquez ici pour en savoir plus et lire des extraits. Cliquez sur le livre pour le commander chez l’éditeur.
Lettres à ma génération ed Michel Lafon. Cliquez ici pour en savoir plus et lire des extraits. Cliquez sur le livre pour le commander chez l’éditeur.



 Français
Français English
English












