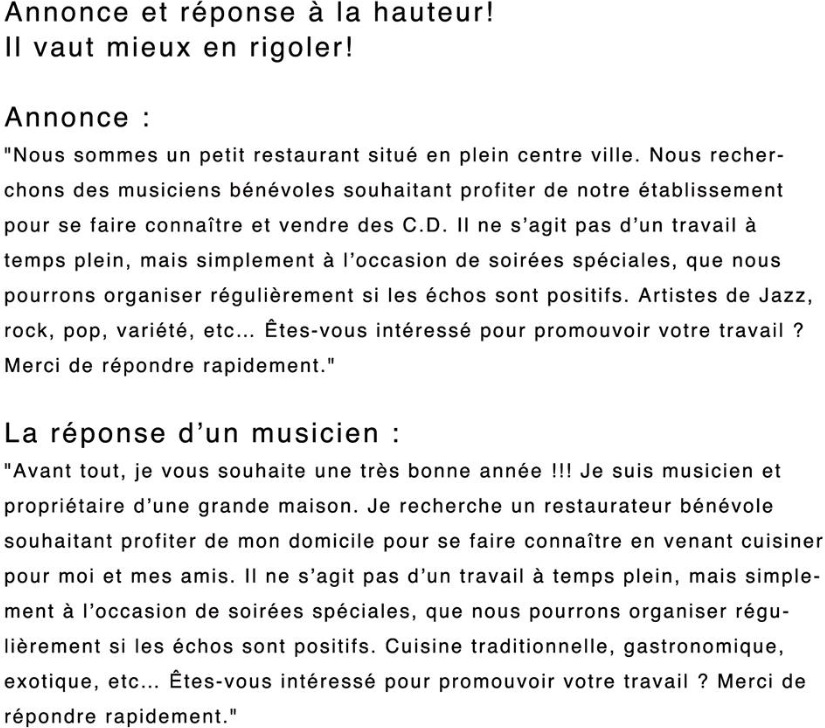Cher lecteur,
Si nous te disons tu, c’est parce que c’est à toi, petite individualité sur deux pattes, que notre travail s’adresse. C’est en toi qu’il résonne et c’est pour toi que nous le faisons. Si je dis nous, c’est parce que je ne suis qu’un parmi tant d’autres, jeunes créateurs, diseurs, faiseurs, qui cherchons une autre manière de travailler, de créer, d’exprimer le monde et d’y agir.
Nous t’écrivons de la terrasse d’un café, sur la petite place d’un de ces vieux centre villes qui finissent par tous se ressembler, entre les boutiques d’artisanat local fabriqué à trois cents kilomètres, celles des grandes enseignes, et les petits restaurants locaux dont les prix ne sont accessibles qu’aux touristes.
C’est samedi. L’artère principale ne désemplit pas. Deux adolescentes flashent sur un vernis à ongle dans une boutique de maquillage – 3.90€. Un petit garçon tend la main vers le paquet de bonbons multicolores exposé dans la vitrine d’une boulangerie – 1.50€. Un couple regarde des coussins de décoration – 15.99€, un autre le prix d’un balayage de mèches chez le coiffeur – 80€ . Un panini coûte 3€, un café à 2€, une crêpe appelée La Provençale 12€.
En face d’un chocolatier, un jeune homme est assis en tailleur sur le trottoir. Il tient un bout de carton avec marqué J’ai faim. Ça doit être son premier jour. L’indifférence n’a pas encore terni son regard. Ses yeux cherchent encore une voie de sortie. Sa barbe blonde est bien taillée. Il n’y a pas grand chose qui nous sépare. Un pas. Un pas de côté. Aujourd’hui, je dois tenir avec deux euros vingt pour travailler jusqu’au soir dans un café. Travailler, c’est à dire avancer un manuscrit qui s’ajoutera à ceux perdus dans une pile chez des éditeurs. Ça, c’est le vrai travail. Mais il ne pourra pas prendre tout mon temps. Car il faut encore réaliser un montage de trois minutes pour le prochain portrait sonore, pour vous donner envie de l’acheter. Vérifier la liste des sans réponse de ce dernier mois, et préparer les mails pour les relancer. Chercher de nouveaux médias à qui proposer des articles, chercher des radios pour diffuser des textes sonores. Prospecter, relancer, proposer, présenter, faire savoir…
 Voilà quelques temps déjà que tu nous connais. Il y a un peu plus d’un an, tu fus un million et demi en trois jours à lire une lettre postée sur Mediapart. Depuis, tu es des centaines à écrire à Sarah. Tes messages lui rappellent que oui, il faut continuer, s’accrocher, que ça a du sens, que quelque chose bouillonne. Parfois, ces conversations par écrans interposés sont le prélude de rencontres, et nous nous retrouvons quelques semaines plus tard dans un café, une bibliothèque, un théâtre d’un coin de France, à parler de la société que nous voulons construire, de nos peurs, de nos défis, de nos envies. À tous les passeurs qui permettent ces rencontres, merci.
Voilà quelques temps déjà que tu nous connais. Il y a un peu plus d’un an, tu fus un million et demi en trois jours à lire une lettre postée sur Mediapart. Depuis, tu es des centaines à écrire à Sarah. Tes messages lui rappellent que oui, il faut continuer, s’accrocher, que ça a du sens, que quelque chose bouillonne. Parfois, ces conversations par écrans interposés sont le prélude de rencontres, et nous nous retrouvons quelques semaines plus tard dans un café, une bibliothèque, un théâtre d’un coin de France, à parler de la société que nous voulons construire, de nos peurs, de nos défis, de nos envies. À tous les passeurs qui permettent ces rencontres, merci.
Chaque jour Sarah reçoit des dizaines de messages de toi. Tu lui dis que ses mots ont changé quelque chose dans ta vie, que tu y retrouves ce que tu as toujours ressenti, tu lui parles de ta situation, de tes questionnements. Elle répond à chacun. Elle sourit quand tu t’excuses de la déranger, quand tu lui écris qu’elle n’aura sûrement pas le temps de répondre. Elle se demande quelle image tu te fais de sa vie. Internet est une vitrine. Tout y est affichage : affichage d’humeur, de statut, d’information. Sur internet, il faut toujours dire que tout va bien. Mettre des points d’exclamation. Montrer aux gens que ça marche, pour qu’ils viennent. C’est la règle : on achète les livres qui se vendent bien et sont aux premiers rayons des libraires, on va voir les spectacles qui remplissent déjà les salles, on clique sur les publications les plus partagées.
Quand tu écris à Sarah, tu ne te contentes pas de flatteries. Tu livres tes fragilités et tes doutes. Tu l’invites à une intimité. Alors aujourd’hui, nous allons répondre à ton invitation. On va te parler de ce travail qui est le nôtre, de cette vie étrange de créateur sur internet. On te parlera sans détour et sans précaution, honnêtement et directement.
“Avec internet, tu peux atteindre plus de monde !”
On nous dit souvent que nous avons la chance de vivre dans un monde où, grâce à internet, nous pouvons partager nos créations directement avec les gens, et toucher un public très large. Partager, c’est là le mot utilisé. Mais dans partage, il y a échange. Or, quand un créateur met en ligne ses créations gratuitement, sache qu’il ne partage pas. Il ne te les offre même pas, car dans offrir, il y a encore de l’échange : le sourire de la personne à qui tu offres, le plaisir de voir l’effet produit. Derrière l’écran, rien de tout ça. Nous balançons nos créations dans cet espace intersidéral, et c’est tout. C’est un courrier qui n’attend aucune réponse.
 Le créateur qui met son travail en ligne a tout de l’artiste ambulant. Il a travaillé pendant des semaines, des mois, des années, sur sa création. Comme il veut te présenter le meilleur travail possible, il a cassé sa tirelire pour acheter du bon matériel : un micro, une carte son, une caméra, un logiciel. Il passe quelques semaines à se tailler un beau site internet, comme l’artiste ambulant dépensera ce qui lui reste pour s’acheter un beau costume. Quand il poste un contenu sur internet, il met ses mains en porte-voix, et te crie : “Regarde mon travail, regarde ce que je sais faire ! ” Toute la difficulté consiste à attirer ton attention, pour que tu t’arrêtes quelques secondes devant sa publication. Il réécrit plusieurs fois le chapeau de son article, réfléchit bien aux mots clés, crée des teasers, des B.O, des montages courts, des formules, des posts sur Facebook. L’artiste ambulant ne choisit pas son heure au hasard. Il sait qu’il faut t’attraper quand tu auras l’esprit libre, dans le métro en revenant du boulot, ou le dimanche matin. Le meilleur article peut passer à la trappe s’il n’est pas posté à la bonne heure.
Le créateur qui met son travail en ligne a tout de l’artiste ambulant. Il a travaillé pendant des semaines, des mois, des années, sur sa création. Comme il veut te présenter le meilleur travail possible, il a cassé sa tirelire pour acheter du bon matériel : un micro, une carte son, une caméra, un logiciel. Il passe quelques semaines à se tailler un beau site internet, comme l’artiste ambulant dépensera ce qui lui reste pour s’acheter un beau costume. Quand il poste un contenu sur internet, il met ses mains en porte-voix, et te crie : “Regarde mon travail, regarde ce que je sais faire ! ” Toute la difficulté consiste à attirer ton attention, pour que tu t’arrêtes quelques secondes devant sa publication. Il réécrit plusieurs fois le chapeau de son article, réfléchit bien aux mots clés, crée des teasers, des B.O, des montages courts, des formules, des posts sur Facebook. L’artiste ambulant ne choisit pas son heure au hasard. Il sait qu’il faut t’attraper quand tu auras l’esprit libre, dans le métro en revenant du boulot, ou le dimanche matin. Le meilleur article peut passer à la trappe s’il n’est pas posté à la bonne heure.
Le mythe : “Si tu as du talent, tu vas y arriver”
Ce jeune créateur dont nous te parlons a grandi dans une société où on lui dit que si on fait du bon travail, si on a du talent, si on s’accroche, on est récompensé. Bel idéal qui suppose que les gens ne s’y trompent pas. Alors il se dit que si tu aimes ce qu’il te donne gratuitement, tu achèteras le reste. On lui a dit qu’il fallait d’abord se faire connaître, et ensuite espérer vendre. D’abord travailler, ensuite proposer son article, son film, ses photos, son reportage. Comme des salles proposent aux musiciens de venir jouer gratuitement, de nombreux sites proposent aux créateurs de publier contre de la visibilité. C’est le nouveau graal : la visibilité.
Quand il est encore dans son antre à créer, et qu’il voit le bout d’une oeuvre, les murs de sa chambre font un drôle de bruit. C’est que ses rêves sont trop grands, ils les font craquer. Il se dit que ça y est, cette fois ça va marcher. Non, ne t’inquiète pas, il n’est pas de ceux qui rêvent de succès facile et de gloire. Sa seule prétention est de pouvoir sculpter, dans la matière qu’il a choisie, quelque chose qui lui permettra de manger, de se loger, assez pour que son travail occupe le centre de sa vie et qu’il ne soit jamais relégué en périphérie, dans les miettes du temps que lui laissera son boulot de survie.
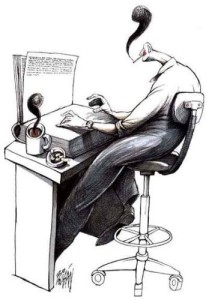
Et puis avec le temps, de coup d’essai en tentative, de projet en projet, les murs de sa chambre finissent par se taire. Le jeune créateur a appris à rabaisser ses attentes. S’il pouvait déjà se rembourser ses frais, il serait satisfait. Imagine, dans ton travail, n’avoir d’autre espérance que celle de te rembourser tes frais de déplacement, de téléphone ou de papèterie.
Il passe plus de temps à agiter les bras pour attirer ton attention qu’à créer. Imagine un circassien qui passerait plus de temps à te crier de venir voir son spectacle qu’à répéter son numéro. Toute cette gesticulation devant l’écran l’épuise, assèche ses instincts, coupe sa réflexion. Il perd ce rythme de la création qui fait qu’un musicien devient bon en jouant, chaque jour. Il sait qu’il pourrait aller beaucoup plus loin s’il était libre. Il se sent la taille d’une comète à qui on offrirait l’étendue d’un bac à sable.
Il se sent pris dans l’obligation de poster régulièrement, pour ne pas te perdre, pour que tu vois qu’il est actif. Le vois-tu, certains soirs, les yeux rougis par l’écran, le rond brun de la tasse qui se superpose aux autres sur son bureau, faire craquer son cou, dans le silence de sa chambre, après avoir passé cinq heures à bien arranger un extrait de son travail pour te donner l’envie de lire, de regarder ou d’écouter ce qu’il fait ?
Bien sûr cette vie, il l’a choisie. En fait, il a choisi de ne jamais donner priorité à autre chose qu’à son vrai travail. Mais il n’a pas choisi le reste. Passer une heure à choisir une police pour que le visuel soit beau et attire l’attention de l’internaute, ça il ne l’a pas choisi. Il sait bien qu’il ne sera jamais payé à l’heure, ni même à la valeur réelle de son travail. Soit. Il ne demande qu’une chose : pouvoir gagner assez pour se nourrir, se loger, se chauffer, et pour avoir le temps de continuer à créer. Parfois il s’imagine qu’un de ses pairs qui aurait déjà fait ses preuves, lui propose une chambre dans sa maison, qu’il puisse venir y travailler le temps qu’il a besoin. Il souffre du manque de lien intergénérationnel entre les créateurs. Les anciens sont bien trop occupés pour daigner répondre aux petits jeunes. La transmission qui a pu exister entre le maître et l’apprenti, le simple lien de confiance qui autoriserait un jeune à se confier à un grand frère, une épaule pour se reposer, une oreille pour accueillir les découragements comme les excitations, ou bien simplement, un moment qui ne soit pas dérobé à l’urgence, une soirée où quelque chose se dépose, tout cela semble avoir été balayé.
Pourtant, au milieu de cet isolement des individus et des générations, certains tentent autre chose. On s’invente d’autres manières de faire, soi-même, sans intermédiaire, dans l’entraide, le troc, l’échange. Pour la nourriture, le transport, les services. Mais pas encore pour l’immatériel. Il ne viendrait à l’esprit de personne de ne pas payer son café. Mais payer un enregistrement, une chanson, de la musique, une photo…
Les nouveaux métiers à inventer
Le 10 janvier 2017 en rallumant son ordinateur, Sarah trouve quatre-vingt seize messages datés du jour-même. Elle comprend que c’est aujourd’hui qu’a été postée la lettre Trouve le verbe de ta vie sur le site de la Relève et la Peste, un de ces nouveaux médias qui te propose de te faire voir le monde autrement. Elle apprend qu’en vingt-quatre heures, cette lettre a été partagée 50 000 fois. Donc lue par quelques centaines de milliers de personnes.
Entre le 1er janvier 2016  et le 9 mars 2017, les portraits sonores L’extraordinaire au quotidien (en cliquant ici tu arriveras sur la page) ont récolté 256,50€, grâce à 23 acheteurs. Soit 85€ par mois. Dans ce même laps de temps, quelques dizaines de milliers lecteurs sont venus sur les pages de ces portraits. Voilà plus de six mois que le matériel d’enregistrement à 2000€ n’est pas sorti de son sac, qu’aucun nouveau portrait n’a été enregistré. Parce qu’il faut d’abord essayer de diffuser ce qui a été fait. Chaque portrait prend environ un mois de travail à temps plein. Ils sont vendus à prix ouvert – tu peux y mettre entre 50 centimes et 20 euros. L’équivalent d’un café, d’un ticket de métro, d’un sandwich. Tiens, la ville change de costume, c’est la fin de l’après-midi. L’heure de l’apéro, le Vittel menthe à 3.20€. Un fond de sirop sucré et de l’eau. Si 10% des 50.000 personnes qui ont partagé la lettre donnait 1€ pour écouter un portrait de 30 minutes… 1 mois de travail… 1€… 10% de 50.000… 5000€, de quoi vivre largement pendant un an.
et le 9 mars 2017, les portraits sonores L’extraordinaire au quotidien (en cliquant ici tu arriveras sur la page) ont récolté 256,50€, grâce à 23 acheteurs. Soit 85€ par mois. Dans ce même laps de temps, quelques dizaines de milliers lecteurs sont venus sur les pages de ces portraits. Voilà plus de six mois que le matériel d’enregistrement à 2000€ n’est pas sorti de son sac, qu’aucun nouveau portrait n’a été enregistré. Parce qu’il faut d’abord essayer de diffuser ce qui a été fait. Chaque portrait prend environ un mois de travail à temps plein. Ils sont vendus à prix ouvert – tu peux y mettre entre 50 centimes et 20 euros. L’équivalent d’un café, d’un ticket de métro, d’un sandwich. Tiens, la ville change de costume, c’est la fin de l’après-midi. L’heure de l’apéro, le Vittel menthe à 3.20€. Un fond de sirop sucré et de l’eau. Si 10% des 50.000 personnes qui ont partagé la lettre donnait 1€ pour écouter un portrait de 30 minutes… 1 mois de travail… 1€… 10% de 50.000… 5000€, de quoi vivre largement pendant un an.
Qu’est-ce que j’ai mal fait, mal pensé, mal évalué ? Le métier d’agitateur sur internet n’est pas inné, ce n’est pas le nôtre, et ce n’est pas lui que nous avons choisi. Internet est un outil et non une fin. Il faut se remettre en question. Mais le travail de créateur ne dépend pas que de soi. Alors nous nous interrogeons sur toi, lecteur. Incompréhension, stupeur. Et oui, colère (On t’a promis que cette lettre sera honnête) Bien sûr, tu es sans cesse sollicité. Les numéros inconnus qui t’appellent après le travail pour te proposer des produits, les campagnes de don des associations, et puis nous sommes des centaines, des milliers d’artistes sur internet à te demander d’encourager notre travail. Tu ne peux pas donner de partout. Bien sûr. Et le Vittel menthe à 3.20€, et le coussin de décoration, et le sandwich. Bien sûr nous ne sommes qu’une fraction de secondes dans ta vie sur internet, et nous devrions nous estimer heureux que tu t’arrêtes pour cliquer, pour liker, pour partager. Bien sûr il y a les guerres d’Irlande…
On nous conseille parfois de faire des levées de fond sur des sites participatifs. Mais c’est encore de l’aumône. Nous voudrions autre chose. Nous prétendons que nous faisons un travail qui mérite rémunération. Comme le Vittel, comme le sandwich, comme le vernis à ongle.
Cette autre société dont nous rêvons
À l’heure où la France s’inquiète de son avenir, tu dois te dire qu’il y a d’autres priorités. Mais c’est au contraire le meilleur moment, pour te parler de ces jeunes qui essayent de se réinventer leur métier, qui cherchent d’autres modèles économiques. Et qui n’y arriverons pas sans toi. Comme aucun artiste, aussi génial, talentueux et travailleur fut-il, n’a réussi sans l’aide, l’écoute et la disponibilités de ses pairs.
Alors, nous diras-tu, quel est le but de cette lettre ? Te faire culpabiliser ? Sûrement pas. Simplement te rappeler à ton pouvoir de consommateur, toi la paire d’yeux qui es en train de lire ces lignes entre deux urgences. Toi qui lis, qui commentes, qui partages derrière ton écran, sache que chacun de tes clics est un geste que tu poses dans le circuit de la création et des médias. Toi qui te plains peut-être d’entendre toujours la même chose dans les médias, toi qui voudrais autre chose. Tu n’es pas invisible, tu n’es pas anodin. La société est comme la peau d’un tambour : chaque geste que tu fais et que tu ne fais pas, résonne à l’autre bout. Chaque fois que tu achètes, et chaque fois que tu n’achètes pas, tu choisis le monde auquel tu participes. Celui de demain, celui de tes enfants. Le nôtre, le mien. Celui qui me fera continuer ou celui qui me fera un jour tout poser par terre, et m’assoir en tailleur sur le trottoir avec une petite pancarte.
Pour acheter un portrait, il suffit d’aller sur cette page (cliquez ici), de choisir le portrait qui t’intéresse (extraits en écoute libre) et de cliquer sur le bouton Acheter en sélectionnant le prix que tu souhaites mettre. Tu seras redirigé sur une page Paypal, en descendant tu cliques sur «Payer sans ouvrir de compte».



 Français
Français English
English