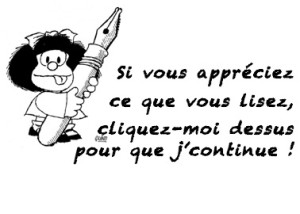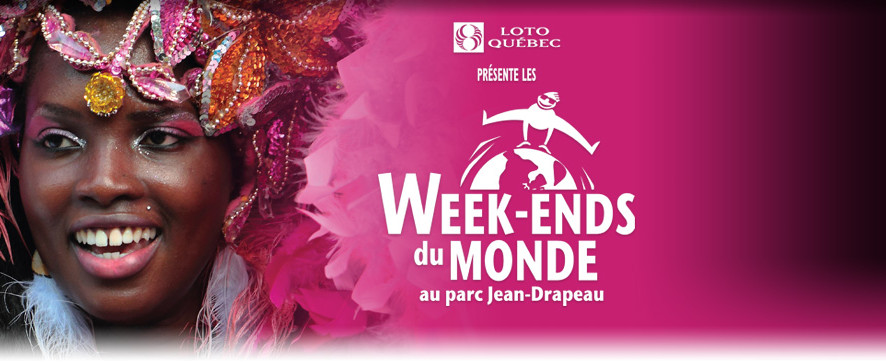Au XVIIe siècle, les femmes de la noblesse portaient trois couches de jupes, qu’on appelait « la modeste », la « friponne » et « la secrète ». Trois couches de tissu mais aussi de caractère. Dans toutes les langues du monde, les petites phrases anodines et formules de politesse portent aussi plusieurs jupons. Soulevons donc la jupe de trois petites phrases qui reviennent presque à chaque fois que nous rencontrons quelqu’un.
Le jupon de soie
« Bonjour ça va bien ? » Serveur d’un restaurant qui vient prendre la commande, commis de caisse où l’on vient de déposer nos marchandises, répètent cette phrase des centaines de fois par jour. Au Québec, le « ça va bien » est phatique, comme dirait le linguiste Jakobson, il sert à établir un contact. Autrement dit, la personne qui dit cette phrase ne se soucie pas de savoir comment vous vous portez, mais cherche simplement à établir un contact.
– Bonjour ça va bien ?
– Oui et toi ?
– Très bien merci.
Cet échange qui se répète des centaines de fois par jour dans chaque café et restaurant, n’est pas un dialogue, car il n’y a pas d’échange où ce que dit l’un influence ce que répondra l’autre. Le serveur peut aller très mal, et vous aussi. Un jour dans une épicerie, j’ai fait l’expérience :
– Bonjour ça va bien ?, me demande le commis sans m’accorder un regard.
– Non et toi ?
– Bien merci.
Le « ça va bien » est sympathique, mais si léger qu’il s’envole à la moindre tentative de le toucher. Des mots légers, un dialogue inexistant…un schéma qui prend une autre ampleur quand il s’applique en politique ou en droit. Ce sont pourtant bien des mots, seulement des mots, qui font nos lois.
Le jupon-drapeau
Soirée entre amis, rencontre professionnelle, la formule est toujours la même : « prénom + enchanté ». Et très vite, une question surgit : « Tu fais quoi ? », suivie de près par « Tu es d’où ? ». Question apparemment simple et innocente, qui peut amener une réponse très complexe. Je peux être né quelque part où je n’ai pas grandi, et me sentir chez moi ailleurs. Mais sous ce premier jupon se cache une autre difficulté : à qui pose-t-on cette question ? À ceux qui n’ont pas la tête de leur voix : un français ou un québécois à la peau foncée, ou une américaine aux traits asiatiques, comme dans la vidéo de Ken Tanaka, artiste illustrateur américain, « Where are you from ? » disponible sur youtube.
Comme cette petite scène le montre très bien, ce que cherche la personne qui pose cette question est une chose bien précise : l’origine ethnique et la filiation. Dans les premiers échanges d’une rencontre, on cherche à récolter des informations sur la personne pour la cerner. Si je te demande d’où tu es, c’est parce que vraisemblablement tu n’appartiens pas au type physique que je définis comme français, québécois, américain, etc. Deux québécois typés caucasiens qui se rencontrent ne se cherchent pas à savoir tout de suite de quelle région ils sont, cela peut venir de façon anecdotique dans la conversation. Pour une personne dont le physique suggère une origine non européenne, on fronce les sourcils : « No, where are you FROM ? ».
Sur ce jupon-drapeau sont fixées les couleurs de l’appartenance nationale ethnique. Une fois déplié, on y trouve la notion de « pure laine », de « français de souche », de « WASP », et l’idée qu’une personne aux origines européennes est moins définie par son ascendance que ceux d’origines non européennes. Mais la question « tu es d’où » jaillit aussi dans l’esprit communautaire, quand des immigrants cherchent à se reconnaître entre eux.
Quand enfin le nom d’un pays exotique est lâché, soulagement, le mystère (et le jupon) est levé. La conversation peut continuer : « Et tu fais quoi ? »
Le jupon usé
« Tu fais quoi ? » C’est à dire, tu fais quoi dans la vie pour gagner de l’argent. Une phrase qui sous-entend que l’activité économique est le centre de son agir, et définir notre être. Je te demande ce que tu fais, mais tu me réponds « Je suis professeur / banquier / chercheur / médecin ». Dans la situation actuelle où le divorce est de plus en plus fréquent entre job alimentaire et travail où l’on se réalise, cette phrase appelle une réponse hésitante. Ce que je fais ? Je cherche, je prospecte, je démarche, pour faire ce que je suis. On serait tenté de remplacer le jupon usé « Tu fais quoi ? » par « Tu cherches quoi ? ».
Bien sûr ces phrases sont juste histoire de dire, ce sont des formules. Mais les petites phrases, les petits gestes, sont ceux par lesquels on installe un rapport aux autres et au monde. Ils sont si petits qu’on ne songe pas à les questionner, et si bien ancrés en nous qu’on en oublie qu’ils sont déjà un conditionnement social et psychologique. Le jupon n’était pas qu’une étoffe au XVIIe siècle, il était un indicateur social, familial, de goût et de suggestion sexuelle. Nous habillons nos discussions comme notre corps, alors mieux vaut, avant de les sortir, jeter un coup d’œil dans le miroir.



 Français
Français Español
Español