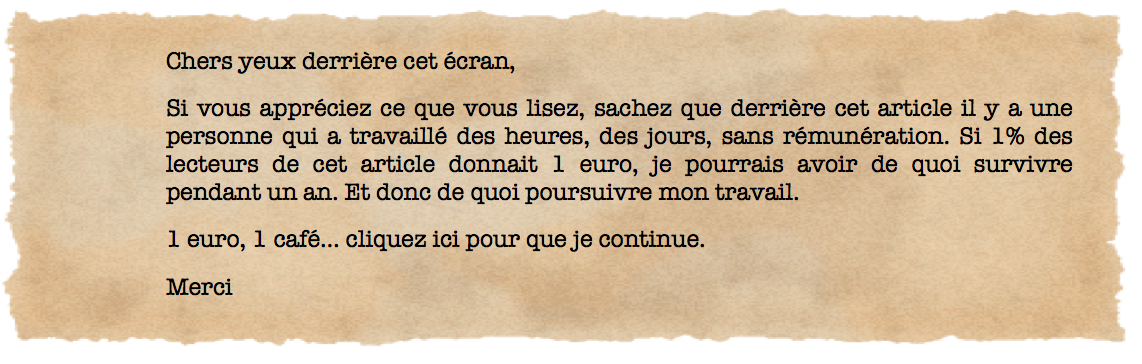 Hier, Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat. Depuis on condamne à juste titre, on s’offusque, on résiste, on prévient des conséquences, on allume des villes aux couleurs du climat… vert. On se rassure. Nous sommes du bon côté de la barrière. Surtout devant un tel amas de bêtise, d’ignominie et de mégalomanie.
Hier, Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat. Depuis on condamne à juste titre, on s’offusque, on résiste, on prévient des conséquences, on allume des villes aux couleurs du climat… vert. On se rassure. Nous sommes du bon côté de la barrière. Surtout devant un tel amas de bêtise, d’ignominie et de mégalomanie.
Mais que la critique indispensable de cet acte ne nous fasse pas endosser trop vite le costume de Capitaine Planète. S’insurger contre cette décision est une chose, se positionner en chevalier blanc de la lutte contre le réchauffement climatique en est une autre. La lutte pour sauver notre planète se livre dans le minuscule et dans le grandiose en même temps. Dans les accords signés par les nations et dans les laboratoires des ingénieurs. Dans notre main qui se tend vers un produit dans le rayon d’un magasin et dans notre capacité à transmettre aux plus jeunes la conscience du précieux et de la fragilité du vivant. Dans le courage des politiques et dans la responsabilité de chaque individu.
Ce que Donald Trump vient de faire à l’échelle d’un accord international, ne le fait-on pas à notre échelle chaque jour ? Dès qu’on demande un sac plastique, dès qu’on achète un briquet en plastique, dès qu’on utilise un produit ménager toxique, dès qu’on achète des fruits hors saison, dès que nous votons pour ceux qui n’accordent aucune priorité à la protection de l’environnement ? Est-ce qu’on ne se retire pas alors du pacte que tout être vivant contracte avec la terre dès sa naissance ? Donald Trump n’est pas une anomalie ni une excroissance. Il est le produit parfait de la société de consommation à laquelle nous participons chaque jour, d’une vision à court terme, de la priorité donnée aux profits immédiats économiques, de notre refus de voir la réalité.
Il serait peut-être temps d’assumer nos miroirs. Tous nos miroirs. Comme ceux qui dorment dans le sable des îles Midway. 6.2 km² en plein milieu de l’océan Pacifique qui nous renvoient l’image de la lente agonie que nous faisons subir à notre maison et à notre nourricière.

Elle a parcouru des centaines de kilomètres au-dessus du grand bleu menteur pour nourrir ses petits. Ici, à des dizaines de milliers de kilomètres des hommes, Diomédéidé, le géant des mers, glisse au-dessus du plus vaste océan du monde.
Sur le sable, ses petits essayent de piquer le ciel du bout de leur bec minuscule. Quand leur mère revient, ils se grimpent les uns sur les autres pour recueillir le baiser nourricier. Baiser de la mort. Du gosier de la mère glissent des proies de toutes les couleurs et de toutes les formes.

Ici, la plage forme une étrange mosaïque de bas reliefs colorés que le vent décompose. Dans un cercle parfait, des plumes, des os, et un long bec, couloir par où sont passés une brosse à dents bleue, un rasoir rose, un briquet violet.
Au milieu de ce cimetière, un nouveau tableau est en train de naître. Un oisillon enfonce la tête dans son duvet encore tacheté. Il pousse de petits cris, se tort, se redresse, retombe sur le côté, essaye de repousser le mal avec ses petites pattes affolées. Mais le mal vient de dedans. Il étouffe, il se racle le fond du bec mais rien ne sort. Il ne sait pas de quoi il meurt. Quelque chose est en lui, un corps étranger qui pousse sur les parois de son ventre.
 C’est ici, au pays des géants des mers, qu’il faut venir, pour trouver le tableau complet de notre siècle. Au bord de ce grand bleu menteur qui fait croire à une nature vierge, il y a ma brosse à dents, mon briquet, mon playmobil, dans un cercle d’os bordé de plumes, à des centaines de milliers de kilomètres de chez moi.
C’est ici, au pays des géants des mers, qu’il faut venir, pour trouver le tableau complet de notre siècle. Au bord de ce grand bleu menteur qui fait croire à une nature vierge, il y a ma brosse à dents, mon briquet, mon playmobil, dans un cercle d’os bordé de plumes, à des centaines de milliers de kilomètres de chez moi.
 Voilà que le cadavre d’un oiseau me tend le miroir de ma responsabilité. Infime et infinie. Je soupèse mon insignifiance et ma toute-puissance. Diomédéidé.L’objectif du photographe vient gonfler ce mot d’un sens nouveau. Je mesure le pouvoir de destruction de l’infiniment petit. Dans le ventre de chaque oiseau mort sur cette plage, c’est l’œil de la terre qui me fixe. Bientôt le vent les fera disparaître sous le sable, avant que notre folie n’emporte ce grain improbable qu’est la terre.
Voilà que le cadavre d’un oiseau me tend le miroir de ma responsabilité. Infime et infinie. Je soupèse mon insignifiance et ma toute-puissance. Diomédéidé.L’objectif du photographe vient gonfler ce mot d’un sens nouveau. Je mesure le pouvoir de destruction de l’infiniment petit. Dans le ventre de chaque oiseau mort sur cette plage, c’est l’œil de la terre qui me fixe. Bientôt le vent les fera disparaître sous le sable, avant que notre folie n’emporte ce grain improbable qu’est la terre.
Le jour où Diomédéidé aura avalé tous les continents de plastique, quand son cri gris couteau aura vidé les ciels, quand le sable de toutes les plages et les profondeurs de toutes les mers auront avalé la soupe de plastique, le vent pourra se mettre à raconter l’histoire d’une calamité qu’on appelait Homme.
Sarah Roubato a publié Lettres à ma génération chez Michel Lafon. Cliquez ici pour en savoir plus et lire des extraits. Cliquez sur le livre pour le commander chez l’éditeur.
Sarah Roubato organise une tournée cet automne, pour y participer cliquez ici.



 Français
Français Español
Español

Bonjour Sarah,
je n’ai pas de fric à vous envoyer et franchement je le regrette, mais des mercis, ça oui !
Merci Sarah parce que franchement c’est exactement ça et c’est si bien écrit…
Je vous deco Bref aujourd’hui, via “lettre à un ado”.
Quelle belle plume vous avez.
Oui vous avez un vrai talent pour écrire.
Votre texte sur Diomédéidé m’a serré le ventre. J’ai mal en pensant à ce que l’homme fait de sa planète.
Et ca me bouleverse quand je pense à mes jeunes enfants.
Que peut on faire?
Agir au quotidien par des petits gestes, faire de mieux en mieux.
Cependant , Comme vous le dites , ces gestes paraissent si petits que s’en est décourageant… .
Je me préserve en m’informant le moins possible sur toutes ces horreurs, parce que je sens que je n’aurai pas la force de continuer à vivre devant les monstruosités qu’il se passe.
Comment faire pour transmettre à mes enfants un Bonheur de vivre et une confiance dans la vie et l’humain ?
Ce sont ceux qui gardent les yeux bien ouverts sur les horreurs qui agissent pour un monde meilleur. JE ne crois pas que fermer les écoutilles ou s’enfermant dans un petit monde à soi permet de vivre sereinement, ni d’aider à un meilleur monde. Mais il faut un équilibre entre ceux qui luttent au sein de ce qui est défectueux, et ceux qui creusent leurs petits jardins d’autre chose qui pourra servir de modèle.