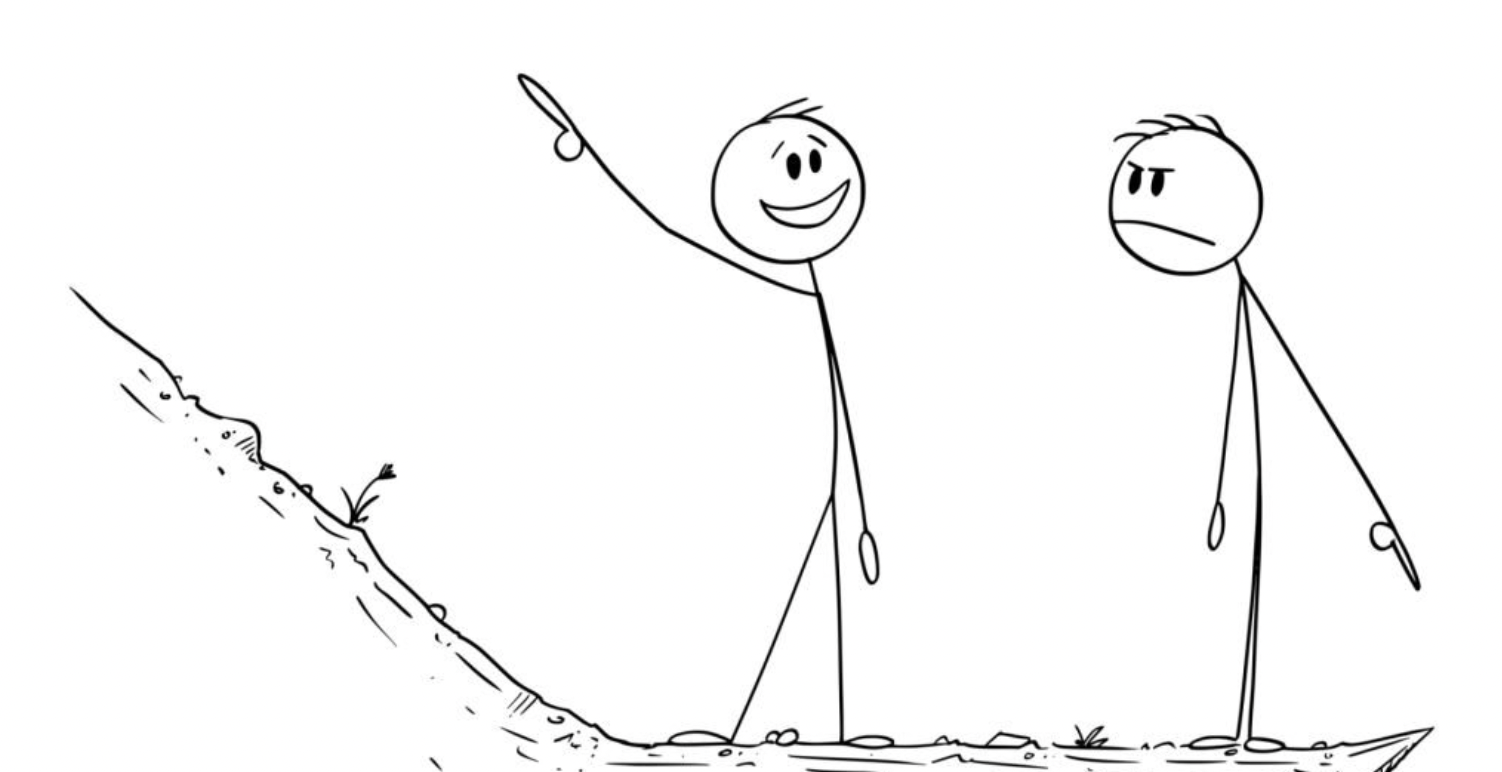Des bisounours niais face à des grognons permanents. Les uns se voilent le réel, les autres empêchent l’espérance.« Je ne perds plus mon temps à écouter les pessimistes ! », disent les uns. « Ils vivent dans leur bulle », répondent les autres. Il y a peut-être autre chose à en dire.
Évidemment nous ne sommes pas entièrement pessimistes ou entièrement optimistes, mais nous savons plus ou moins à quel camp on appartient, et comment nous balayons l’autre d’un revers de main pour conforter notre positionnement. Il y a peut-être une autre manière de faire, dont la première étape est de comprendre l’autre.
L’avalanche quotidienne d’informations agresse nos espérances. Même si on a la force de ne plus les regarder, les petites violences du quotidien prendront le relais. Alors que faire ? Les uns se retirent, contemplent le désastre depuis le balcon et ne s’en étonnent pas. On les appelle les pessimistes. Les autres dressent leur espoir à la face du monde, ne montrent que les belles choses et, vent debout, ignorent les avertissements et les critiques. On les appelle les optimistes. Les deux s’ignorent cordialement et sont déterminés à ne pas comprendre le monde de la même manière.
La fragilité des pessimistes
Comme toujours dans les situations binaires, il suffit de s’approcher un peu pour découvrir la tendresse sous l’armure, et la violence non assumée des beaux sourires. On découvrira alors que les pessimistes sont bien souvent des hypersensibles qui ne supportent pas que le beau, le juste, le méritant, soient abîmés. Quand on voit avec clarté ce que ce jeune pourrait faire si on lui donnait une chance, ce que ce lieu pourrait devenir si on s’y mettait, ce que ce terrain, ce média, ce projet, cette envie, pourraient apporter de bon, alors tout ce qui l’entrave devient proprement insupportable. Et voilà qu’on passe son temps à pointer les bêtes, les hypocrites, les égoïstes, tout ce qui « va mal ».
Bien souvent, les pessimistes sont visionnaires. Ce sont les personnes qui voient les potentiels au-delà des situations, et qui ne peuvent qu’être heurtées au plus profond, de ne pas les voir se réaliser. Car chaque jour, elles assistent à la mort de ce qu’il y a de plus beau. Derrière « le négatif », il n’y a en réalité qu’un « positif » blessé.
La violence et le courage de l’optimiste
Face à la paralysie ou au retrait du pessimiste, l’optimiste a un immense courage : il ne se laissera pas abattre par la violence du monde et il ne se contentera pas de ce qui est. Non décidément, il ne renoncera pas à sa quête d’un meilleur lendemain. Tout le « négatif », il décide de s’en détourner ; quitte à refuser de le voir… quitte à devenir myope.
L’optimiste nous dit : « Oui, il y a tout ce moche, mais je ne vais pas perdre d’énergie à le regarder. Moi je décrète qu’il y aura toujours un meilleur – demain, dans la pièce à côté ou quelque part à l’intérieur de cette personne. Et même si ce meilleur est minuscule, infime, ridicule, je décide de m’y accrocher. » Derrière le « positif », il y a donc un négatif qu’on met au coin.
Deux courages, deux peurs et deux impuissances
Le pessimiste reprochera à l’optimiste de ne pas regarder en face le réel et de ne le nier ; l’optimiste reprochera au pessimiste de renoncer à un changement possible. Le pessimiste a le courage de ne pas détourner la tête de la laideur du monde ; l’optimiste a le courage d’investir l’espérance d’un avenir meilleur.
L’un voit la beauté abîmée et en reste paralysé, l’autre décide de punir le réel et de ne voir que le beau. Les deux ont raison, et les deux sont dans une impasse. Le pessimiste est tétanisé par son hypersensibilité, il ne parvient plus à la convertir en force d’action. L’optimiste vole, danse, broute des nuages, mais la bulle qu’il se construit pour ne pas voir ce qui l’entraverait, l’isole de plus en plus du monde.
Coincés dans leurs conforts respectifs, l’optimiste et le pessimiste se condamnent tous les deux à l’impuissance. L’optimiste en refusant de soumettre ses chimères au réel, le pessimiste en se complaisant dans le spectacle de sa douleur plutôt que dans celui de sa vision.
On ne peut pas se frayer un chemin vers ce qui pourrait être sans prendre la pleine mesure de ce qui est. Pour traverser le champ des possibles, il ne suffit pas de fixer l’horizon, il faut aussi marcher, remuer la fange, et regarder où l’on pose le pied, pour ne pas le poser dans le vide. Mais si on ne regarde que ses pieds, on risque fort de perdre l’horizon et de revenir au même endroit.
Marcher ensemble
On le sait, ce ne sont pas les grincheux pessimistes qui ont fait avancer les choses… bien que la nostalgie aveugle ait le pouvoir de mobiliser les imaginaires et de reconstituer les espérances de « retour à l’ancien monde ». Pour autant, envisager des changements de société sans prendre la peine de s’arrêter devant la souffrance, de l’écouter et de la prendre en compte, ne peut revenir qu’à créer une élite coincés dans un entre-soi positiviste.
À chaque fois qu’il a fallu revoir nos modèles de société, cela s’est fait par la rencontre entre les visionnaires et les négociateurs, entre les idéalistes et les réalistes ; entre ceux qui énonçaient les grands principes et ceux qui s’adaptaient continuellement ; entre ceux qui critiquaient la société telle qu’elle était et ceux qui imaginaient celle qu’elle pouvait être. Et bien sûr, cette rencontre se faisait au sein même d’une même capacité à voir le monde, dans ce qu’il est et dans son potentiel de changement.
Il n’y a pas de personnes optimistes et de personnes pessimistes. Il n’y a que des mécanismes de défense que nous mettons en place pour traverser le réel, et marcher vers nos espérances. Alors, si au lieu de reprocher à l’autre de ne voir que le négatif, on lui demandait : « Vous avez mal où ? ». Et si, au lieu de traiter l’autre de naïf, on lui disait : « Est-ce que vous pouvez tourner la tête un peu par là ? », on pourrait peut-être commencer à marcher ensemble le champ des possibles.



 English
English Español
Español