Il faut l’avoir vu pour le croire. Et peut-être bien qu’il faut y croire pour le voir.
(It is a place that has to be seen to be believed, and it may have to be believed in order to be seen)
Scott Momaday, écrivain autochtone américain
Sancho, fidèle compagnon de Don Quichotte, le Capitaine Haddock, Obélix, Maître Land de 20 000 Lieues Sous les Mers, Philinte ou encore John Adams, l’un des pères de la nation américaine… ces personnages fictifs et réels, continuent de nous chatouiller l’oreille de questions qui sont plus que jamais d’actualité.
À l’heure de la pandémie, les uns s’évertuent à décrier les failles qu’elle révèle de nos sociétés. Les autres appellent à l’instauration d’un nouveau monde. Aux premiers on voudrait dire : « Oui… et après, que fait-on ? ». Aux seconds : « Oui d’accord…mais comment fait-on? » C’est l’éternel débat entre réalisme et idéalisme, entre ceux qui voient le monde tel qu’il est et ceux qui le voient tel qu’il devrait être. Et ces duos fabuleux que nos écrivains ont inventés – Don Quichotte et Sancho, Alceste et Philinte, Haddock et Tintin, Astérix et Obélix, Land et Aronnax, pour ne citer qu’eux, incarnent cette question. Elle se pose à l’échelle des sociétés, mais aussi en chacun de nous.
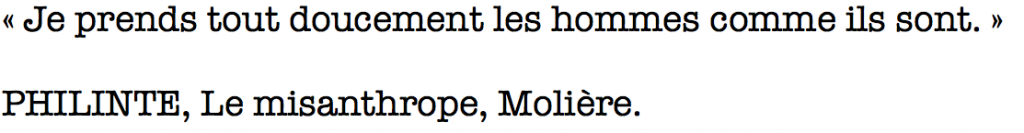
Que faut-il pour changer le monde ? Entrevoir, au-delà des évidences, ce qui aujourd’hui paraît impossible. Pointer le doigt vers un horizon que personne ne soupçonne. Mais il faut aussi baisser les yeux, regarder où l’on marche, pour ne pas, dans cet élan vers l’horizon, poser le pied sur le vide ou trébucher sur le réel. Prendre la mesure du monde tel qu’il est et naviguer pour se frayer un chemin vers ce possible.

Dans 20 000 Lieues sous les Mers, tandis que le professeur Aronnax se passionne pour les inventions et le monde de Nemo, Land, le harponneur, ne cherche qu’une chose : s’évader du Nautilus. Claustrophobe, il a besoin du large et de la terre, tandis que le professeur se délecte dans cette tour d’ivoire sous-marine où il découvre tant de trésors qui ouvrent la conscience humaine et la science. C’est finalement Land qui permettra aux trois prisonniers de s’en sortir vivants. Dans la version de Disney, où il est merveilleusement incarné par Kirk Douglas, Land assomme le professeur qui souhaite revenir au Nautilus pour chercher son journal, et ainsi le sauve. Celui-ci finit par lui dire, et ce sont ses derniers mots : « Vous avez rendu un grand service à l’humanité, maître Land. »
Le danger de la tour d’ivoire, on le retrouve dans tous les milieux et à toutes les échelles. Dans les milieux alternatifs, entre ceux qui font des réunions pour rêver d’un autre monde, organisent des marches et des actions symboliques, et ceux qui montent des lieux, des associations, qui apprennent à faire des compromis, à ne pas demander un changement radical immédiat. Entre ceux aussi qui construisent des lieux clos alternatifs, et ceux qui, de l’intérieur des institutions existantes, tentent de faire bouger les lignes. Les deux sont indispensables. Dans le milieu des sciences sociales, on multiplie les conférences, les colloques, les réunions, les papiers foisonnant d’idées merveilleusement audacieuses, mais qui ne sont jamais soumises à l’épreuve du réel. Dans les médias, on se gargarise de belles entrevues auprès d’un public déjà acquis.

Tintin, c’est le héros désincarné, sans traits précis, sans âge précis. Il semble traverser le réel sans en être affecté, soucieux seulement de sa quête. On le voit froncer les sourcils mais ne jamais être véritablement en colère, jamais soumis à un sentiment qui le déborde. On le voit lever les sourcils de tristesse mais jamais abattu. Même dans sa quête de son ami Tchang, il ne frappe du poing sur la table que pour poursuivre… un rêve, qui le mènera finalement à retrouver son ami. Haddock, lui, n’a pas besoin de rêve pour suivre son ami dans les montagnes du Tibet. Et quand c’est Tournesol qui a disparu, c’est bien parce qu’il est en colère et frappe du pied dans un chapeau, que Haddock découvre le chapeau de Tournesol, que Tintin ne reconnaît pas. Haddock est un révolté. Il rougit, pâlit, bleuit, il boit et il grogne. Il s’esclaffe et grince des dents. Il est vivant.
En chacun de nous aussi, il y a une part désincarnée qui préfère rester dans la sphère des idées, des déclarations, des mots, et une part qui essaye, qui ose, qui met les mains dans le cambouis. On se donne des principes, nobles et pertinents, des conduites de vie, mais il n’est pas facile de les sortir du tiroir pour les réexaminer à la lumière des changements du réel, pour voir s’ils restent pertinents, ou s’il faudrait les adapter. On trouve de belles phrases pour dire aux gens qu’on les aime, qu’on tient à eux, et la communication par tchat et réseaux sociaux permettent de substituer les mots par des cœurs et des citations. Mais combien de fois déclare-t-on aimer derrière un écran, pour combien de gestes, de temps consacré, d’incarnation physique ?

À force de trop se replier, on risque de prendre des moulins à vent pour des géants. « Quels géants ? » demande Sancho. « Il paraît bien que tu n’es pas fort versé en ce qui est des aventures. », réplique Don Quichotte. En effet. Sans la folie de son maître, Sancho serait resté dans un monde étroit. C’est l’équilibre des deux qui permet de creuser d’autres possibles. Car à chaque fois qu’il a fallu revoir nos modèles de société, c’est la rencontre des visionnaires, des idéalistes, des gens qui voyaient au-delà du réel, et des réalistes, qui savaient négocier et s’adapter, qui a permis les révolutions. On ne retient souvent que les idéalistes. Mais rien n’aurait été possibles sans les autres. L’un des plus beaux contrastes dans l’histoire moderne est certainement l’amitié tumultueuse entre John Adams et Thomas Jefferson.
Adams, le colérique, l’homme sans réserve, le piètre diplomate, n’a aucune confiance dans la nature humaine et cherche à freiner les pulsions destructrices des hommes. Il tire ses conclusions de l’observation et de sa pratique de la loi dans son Massachussetts où la classe moyenne émerge. Il est l’homme qui a dû se faire. Jefferson, l’aristocrate de Virginie à qui tout a été donné, l’homme posé, poli, calme, a une confiance débordante dans la nature humaine, qu’il tire de ses lectures et de son amour des arts. Mais il a su ne pas se contenter du monde tel qu’il était et a été bien plus radical dans sa pensée révolutionnaire que Adams. Adams cherche, fouille, observe. Jefferson invente et rêve. Jefferson a vu dans la révolution française l’accouchement douloureux d’un meilleur monde. Adams y a vu le désastre de la Terreur. Ils voyaient tous les deux juste, seulement l’un voyait à cent mètres et l’autre à cent lieues. (2) Adams passa commande à Jefferson de la Déclaration d’Indépendance. Et Jefferson surprit Adams en écrivant un texte qui ne se contentait pas de déclarer l’indépendance des colons, mais qui posait les bases d’une libération de l’humanité entière. Rien de nouveau dans ce texte, dont les idées avaient été formulées par Adams bien avant. Mais tout y est condensé et soutenu par souffle qui porte loin… et qui porte encore aujourd’hui. Ce texte, source de la Déclaration des Droits de l’Homme, est la base de nos sociétés modernes. Aujourd’hui on se souvient de Jefferson qui nous inspire encore, et on méprise Adams qui a tant fait. Et pourtant nous avons eu besoin des deux.
Aujourd’hui, nous sentons les secousses d’un monde qui s’effrite, et les palpitations d’un monde qui cherche à naître. Il nous faudra trouver, en chacun de nous et dans nos collaborations, des Adams et des Jefferson, des Alceste et des Philinte, des Don Quichotte et des Sancho. Pour que le changement qu’il est urgent d’entreprendre puisse s’incarner.
2 Les deux ont condamné l’esclavage. Mais alors que Adams vivait dans un état qui l’avait presque aboli, Jefferson vivait dans une Virginie dont l’économie entière reposait sur cette institution. Devant le principe de réalité, Jefferson s’est embourbé. Ses premières propositions pour abolir l’esclavage ayant été systématiquement repoussées, il a remis aux générations suivantes ce problème, et n’a pas jugé utile de regarder en face sa propre réalité, car il était le deuxième plus grand possesseur d’esclaves de son comté.



 English
English Español
Español